« Les remarques et les comportements sexistes, c’est des pratiques qui découragent beaucoup de jeunes femmes à se lancer dans l’informatique », observe Harmonie, présidente de Hackstub, une association notamment engagée en faveur de l’informatique libre. À 28 ans, elle est experte en sécurité et vie privée chez Eyeo, la maison mère d’AdBlock (un bloqueur de publicités). Elle fait partie des 17% de femmes qui travaillent dans l’industrie du numérique en France. Pourtant après son bac scientifique et malgré son appétence pour l’informatique, Harmonie s’était d’abord orientée vers une licence de droit. Parallèlement, elle avait rejoint l’Amicale des informaticiens de l’Université de Strasbourg (AIUS).

Elle raconte son expérience à la faculté de mathématiques et informatique à partir de 2015 :
« J’étais toujours flanquée à la fac de maths-info et je peux dire qu’il y a beaucoup de harcèlement sexiste et sexuel dans les études en informatique. Moi même j’ai subi de nombreuses remarques sexistes, mais je savais tenir tête, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. »
En 2022-2023, la filière informatique de l’Université de Strasbourg compte 184 femmes pour 933 hommes, soit 16 % de femmes. Et ce manque de parité est, en lui-même, un facteur de découragement. Selon le rapport 2023 sur l’état des lieux du sexisme en France, 22% des femmes de 25-34 ans ont déjà redouté, voire renoncé à s’orienter dans un métier majoritairement composé d’hommes, « par crainte de ne pas y trouver leur place ou de s’y sentir mal à l’aise, mais aussi par peur du harcèlement sexuel pour 18% d’entre elles ».
Après sa Licence, Harmonie a choisi un Master en droit du numérique malgré les réserves de son professeur référent : « Il me disait que ce n’était pas un domaine porteur alors que c’est le cas. De toute façon, je savais que j’étais faite pour ça donc je me suis encouragée toute seule. » Avant d’intégrer Eyeo en 2020, elle a débuté sa carrière dans un cabinet de conseil juridique puis à la Direction interministérielle du numérique (DiNum) à Paris. La Strasbourgeoise assure y avoir été confrontée à un sexisme ambiant :
« C’est souvent des hommes en costume qui m’ont posé problème. À la DiNum, on me prenait régulièrement pour une stagiaire. Même des jeunes hommes en stage étaient plus pris au sérieux que moi. Le sexisme — parce que j’étais une femme, en plus d’être jeune et racisée — était beaucoup plus pernicieux que des mots. Dans le cabinet de conseil, on ne me faisait pas confiance si je n’avais pas l’aval d’un supérieur hiérarchique masculin. À tel point que mon chef de service m’a conseillé de le mettre en copie de tous mes mails, pour que je puisse avancer sur mes dossiers. Ce n’était pas le cas des hommes. »
Selon l’étude Gender Scan 2022 qui mesure l’évolution de la féminisation dans le secteur des technologies et du numérique, 46% des femmes qui travaillent dans le secteur de la technologie déclarent avoir été victimes de comportements sexistes, de harcèlement moral et sexuel voire d’agressions au sein de leur milieu professionnel.
« Il y a urgence à diversifier le secteur du numérique »
Entre 2013 et 2019, le nombre d’étudiantes dans le domaine en France enregistrait une baisse de 2 % — contrairement à la moyenne européenne en hausse de 6 %. En février, les premières Assises nationales de la féminisation des métiers et filières numériques ont été organisées au ministère de l’Économie à l’initiative de l’association Femmes@Numériques en février 2023, au vu de « l’urgence de diversifier le secteur ». Selon le gouvernement, la France nécessitera 400 000 experts et expertes du numérique formés d’ici 2030. Hormis le besoin de main d’œuvre, c’est un enjeu crucial d’équité dans la mesure où ce secteur, qui attire de nombreux investissements, représente une opportunité d’autonomie financière pour les femmes.

Lou est ingénieure système à la direction du numérique (DNum) de l’Université de Strasbourg. Elle expose la situation sur son lieu de travail :
« Au département infrastructure, on est deux femmes sur une trentaine de salariés. On galère tellement à recruter (environ 10 % de postes vacants à la DNum) que la disparité des genres n’est pas un sujet, on n’a pas ce luxe. »
Avant de s’insérer professionnellement dans ce milieu, cette Strasbourgeoise de 30 ans a connu un parcours sinueux, en lien avec les préjugés entourant l’informatique :
« Au lycée, je kiffais l’informatique et je rêvais de faire Épitech. Mais je n’étais pas bonne en maths et mes parents ne m’ont pas encouragée. Aujourd’hui je sais qu’en fonction des domaines, ce n’est pas nécessaire. »
Après un bac en Sciences et Technologies de l’Industrie (STI), et alors que l’informatique la passionne depuis l’enfance, Lou s’est dirigée vers une licence de langues. C’est seulement huit ans et divers métiers plus tard qu’elle s’est réorientée, bien qu’elle n’ait en réalité « jamais arrêté de bidouiller des choses sur l’ordinateur ». En 2020, elle a profité du confinement pour suivre une formation de développement web, « The Hacking Project », et a poursuivi en autodidacte, avant d’être embauchée par l’Université de Strasbourg en mars 2022.
Attirer les candidates, un enjeu pour les formations aux métiers du numérique
Faire de l’informatique sans avoir brillé en mathématiques, c’est possible. Élodie Motsch, chargée de communication de l’école d’informatique Épitech de Strasbourg le confirme :
« Il n’y a pas besoin d’être bon en maths pour faire de l’informatique. C’est une idée reçue à laquelle nous tentons de sensibiliser les étudiant·es et leurs parents. »
En 2021, l’école privée a commandé une enquête sur les raisons de la faible orientation des lycéennes vers l’informatique. À Strasbourg, les femmes ne représentent que 13% de la soixantaine d’étudiants de première année, 7% en deuxième année et 4% en troisième. À l’origine de cette sous-représentation, des préjugés et un faible encouragement des jeunes filles par leur entourage. Selon l’étude en question, 33% des lycéennes sont encouragées par leurs parents à s’orienter vers les métiers du numérique contre 61% des garçons. Pour attirer les candidates et encourager la féminisation de ses promotions, l’école prend quelques initiatives. La chargée de communication d’Épitech Strasbourg explique :
« Pour les journées d’orientation et les salons étudiants, on essaie de mettre en scène la parité pour permettre aux lycéennes de s’identifier à nos étudiantes. »
L’école organise aussi des ateliers de code informatique dans les lycées alsaciens, en partenariat avec l’association EMM-A qui promeut la mixité dans les écoles de la tech. Ces ateliers sont en mixité choisie, en l’absence des garçons. Dans ce cas, cet outil « d’auto-émancipation » vise à favoriser un climat rassurant entre participantes afin qu’elles apprennent sereinement le code informatique.
Mais preuve que la démasculinisation de l’industrie du numérique n’en est qu’à ses débuts, les professeurs d’Épitech Strasbourg sont exclusivement des hommes et aucune cellule dédiée à la prise en charge du harcèlement ou des violences sexistes et sexuelles n’est en place dans l’école. À titre de comparaison, l’université de Strasbourg compte 25% d’enseignantes-chercheuses au sein de la section informatique du Conseil national des universités (CNU).
Pour des outils numériques inclusifs
La conception d’outils informatiques plus inclusifs est aussi un enjeu majeur de la diversification des salariés de l’industrie du numérique. Le plaidoyer publié en février à l’issue des Assises dénonce « les impacts d’une conception et d’une gestion des outils et solutions numériques sans la participation des femmes, [qui] introduisent des biais de genre se [faisant] déjà ressentir. Il n’est pas acceptable que seul 50% du vivier de talents soit aujourd’hui impliqué et mobilisé dans la conception, l’administration et la sécurisation des outils numériques qui régissent notre société ».
Maddie (le prénom a été modifié, NDLR) est graphiste et développeuse web indépendante à Strasbourg. Elle explique :
« La démasculinisation de l’industrie du numérique est importante pour que des personnes qui ne sont pas des hommes blancs se sentent à l’aise de participer, d’apporter leurs visions du numérique, et leurs besoins avec. Tout l’enjeu est de rendre le numérique moins discriminatoire, par exemple dans le domaine de l’accessibilité et du médical. »
À 32 ans, cette Strasbourgeoise originaire des Vosges du nord est diplômée de l’école d’art du Havre. « Je suivais l’option design graphique et interactivité, donc l’ordinateur était mon principal outil de travail, mais avec une approche artistique », relate-t-elle. Comme Lou et Harmonie, Maddie s’est formée en autodidacte grâce à des ressources en libre accès sur internet et ne doit pas son insertion professionnelle à une formation traditionnelle :
« J’ai encore un sentiment d’imposture parce que je n’ai pas de diplôme en informatique. Et cela s’ajoute au fait d’avoir intériorisé l’idée essentialiste qu’en tant que femme, je suis moins apte. »
En 2016, elle a rejoint la communauté de Hackstub. Elle a vu sa fréquentation changer au fil des années. D’un vrai « boysclub » — selon les mots de sa présidente — à une association où des femmes, minorités de genre et personnes racisées participent. Pour encourager ce mouvement, Hackstub a publié en 2021 une charte prônant l’inclusivité. Maddie poursuit :
« C’est important de trouver une communauté de semblables pour affronter des situations d’oppression ou d’isolement, comme cela peut être le cas dans le milieu informatique. Sur le plan économique aussi, cela permet de se créer des opportunités professionnelles, lorsque nous en sommes globalement exclues dans ce milieu. »
Elle cite Les Oubliées du numérique d’Isabelle Collet : « Quand vous imaginez un groupe de programmeurs, est-ce que vous pensez à des filles ? Évidemment que non ! » Malgré de timides améliorations, la démasculinisation de l’industrie du numérique, en pratique et dans les esprits, n’en est qu’à ses débuts.


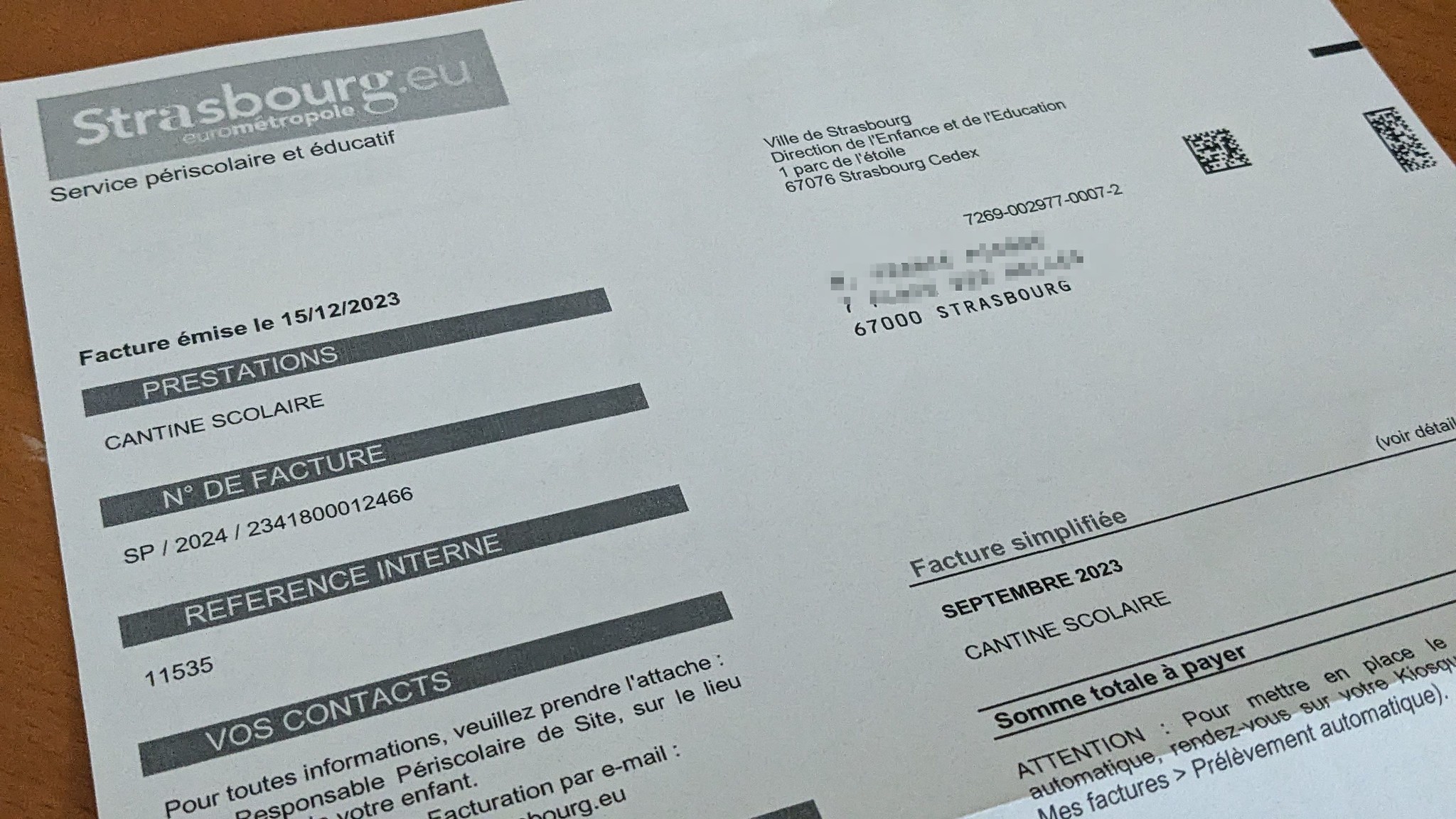
Chargement des commentaires…