Dans Sexualités impudiques…, paru en février, Régis Schlagdenhauffen, maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), s’intéresse au délit d’outrage à la pudeur depuis sa création en 1810 jusqu’à sa suppression en 1994. Basées sur un examen fouillé et une analyse minutieuse des archives judiciaires de plus de deux siècles, ses recherches dessinent les contours moraux de la société française, leur évolution et la façon dont ils façonnent les règles de droit et la répression.
Le livre est aussi éclairant sur les frontières mouvantes de « l’impudeur », de « l’obscène » qui servent à contrôler certains ou certaines plus que d’autres et à la réaffirmation des normes sociales. L’auteur montre également la difficulté de l’appréhension des délits sexuels par les tribunaux : certains dommages bien réels sont ignorés de même que certaines victimes, alors que de nombreuses condamnations pour outrage public à la pudeur visent à protéger l’entité abstraite qu’est la société. Depuis 1994, le code pénal ne poursuit plus que l’exhibition sexuelle.
Rue89 Strasbourg : Pourquoi vous intéresser à l’outrage public à la pudeur (OPP)?
Régis Schlagdenhauffen : J’aime les sujets en marge. Je voulais questionner cette infraction et plus généralement ce que la société entend par « impudeur ». Peu de travaux ont été faits sur le sujet et cela n’était pas satisfaisant selon moi. Il y a bien l’ouvrage de Marcela Iacub (Par le trou de la serrure, 2008, Ed. Fayard) mais elle ne prend en compte que les affaires évoquées en cour de Cassation, qui ne sont pas si nombreuses, cela efface et évacue beaucoup de choses, le tout-venant. Je voulais étudier ce qu’il se passe à la base.
Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture
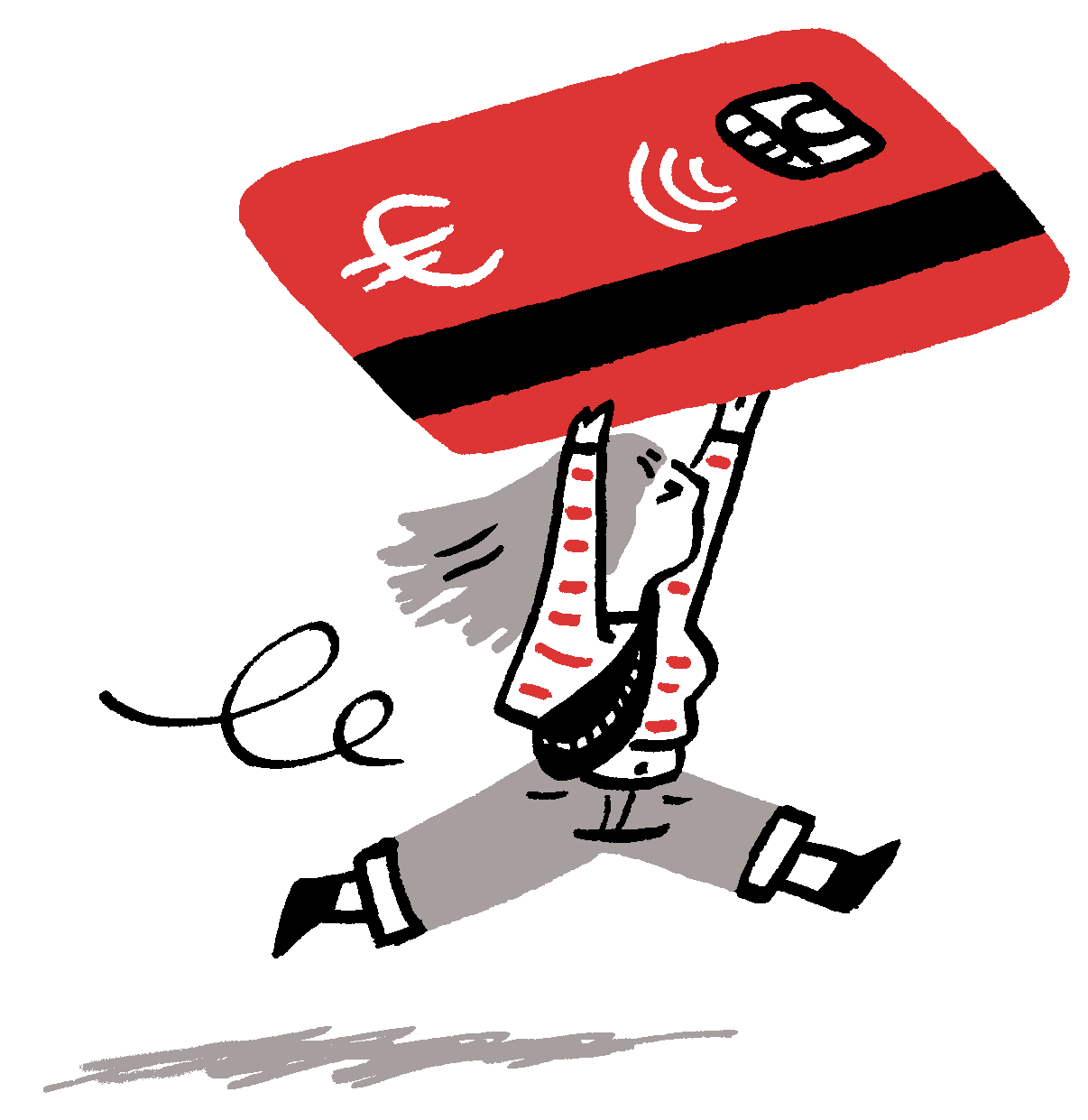
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous



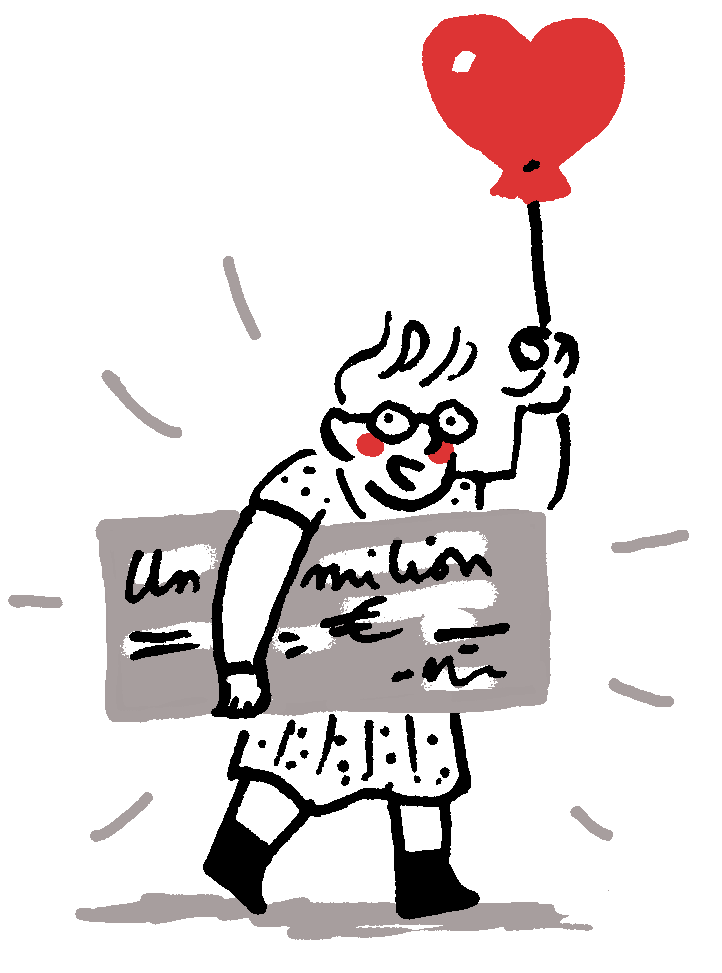





Chargement des commentaires…