Lisez la suite pour 1€ seulement
-
Accédez à nos enquêtes et révélations exclusives
Soutenez une rédaction locale qui appartient à ses journalistes
Maintenez une vigie citoyenne sur les pouvoirs locaux
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
La révolte engagée mi-septembre en Iran contre les exactions de la police des mœurs se poursuit, malgré la répression du régime religieux. Jeudi 8 décembre, Mohsen Shekari, un manifestant de 23 ans, a été exécuté. Le Collectif de solidarité avec le peuple iranien de Strasbourg (Csapi) appelle à un rassemblement silencieux, dimanche 11 décembre à 15h, place de la République à Strasbourg.

Mohsen Shekari avait été emmené par la police le 25 septembre, une semaine après le soulèvement qui a suivi la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée et battue par la police des mœurs pour un voile « mal porté ». Jugé pour « inimitié à l’égard de Dieu » selon une agence de presse du pouvoir iranien, Mohsen Shekari aurait également blessé un membre des milices des gardiens de la révolution, l’armée idéologique du régime.
Selon plusieurs sources, plus de 18 000 personnes ont été interpellées depuis le début du soulèvement et au moins 80 personnes ont été jugées coupables « d’inimitié à l’égard de Dieu » en Iran et pourraient subir le même sort. Au moins 450 personnes ont été tuées dans les rues lors des émeutes.
Tout au long de la semaine, des mobilisations se sont succédées dans les campus universitaires et des grèves de commerçants ont touché une cinquantaine de villes. À Téhéran, des tentatives de manifestations ont à nouveau été réprimées par les forces de l’ordre.

Depuis le déclenchement de l’offensive russe le 24 février 2022, le paysage médiatique occidental est assailli par les images de la guerre en Ukraine. Difficile d’échapper aux clichés de destruction, de corps meurtris et de populations épuisées, tant ils circulent sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et bien qu’il soit nécessaire de rendre compte des horreurs commises, ce constat de saturation a fait émerger une envie, un besoin même, de montrer l’Ukraine sous des jours différents.
La tenue d’événements culturels étant compromise sur le sol ukrainien, Kateryna Radchenko, fondatrice et directrice du festival Odesa Photo Days (consacré depuis 2014 à la promotion du travail de photographes ukrainiens) a concrétisé cette envie au-delà des frontières, sur les murs de La Chambre, place d’Austerlitz à Strasbourg. De l’urgence de la situation est née Paysage présage, une sélection de photographies bouleversantes, toutes réalisées avant l’éclatement du conflit, qui évoquent la singularité des paysages ukrainiens, de l’identité et du quotidien de ses populations.
L’exposition se déroule en trois actes qui, à leur manière, tissent les liens étroits entre le lourd héritage historique du pays et sa situation actuelle. Les subtilités culturelles et géographiques ukrainiennes sont ici complimentées par le large panel de sensibilités plastiques et esthétiques dont fait preuve l’ensemble des artistes représentés.

Les allures post-apocalyptiques de Lviv – God’s Will (2017), œuvre d’introduction de l’exposition réalisée par Via Poliakov, rendent compte de l’état léthargique dans lequel se trouvent une grande partie des villes ukrainiennes. Le fond jaune, qui constitue la seule intervention de l’artiste et rappelle les cieux arides et pollués de certains univers de science-fiction, est pourfendu par les restes d’une statue. Rongée par les êtres et le temps, sûrement soumise à un démantèlement partiel, elle ne laisse entrevoir que son squelette d’acier et quelques figures typiques du réalisme soviétique. Les détails restants font apparaître le buste d’un soldat montant un cheval lancé dans les airs, dans une posture héroïque censée rappeler la « réalité sociale » des combattants et ouvriers soviétiques.
Le mètre cinquante d’envergure de la photographie rend justice à la quête de gigantisme qui animait les commanditaires de tels monuments. Leurs ambitions démesurées sont aujourd’hui confrontées à la réalité et la carcasse flotte toujours dans le ciel, comme un appel à l’humilité.
Le paysage urbain ukrainien porte encore de nombreux stigmates de la domination soviétique. Et si l’effondrement de l’URSS a signifié l’indépendance de l’Ukraine, elle a également signé la dégradation, voire l’anéantissement de ses capacités financières. Les villes se sont vues livrer à elles-mêmes, privées de tout plan d’urbanisme et d’institutions les encadrant, ainsi condamnées au délabrement.
L’exposition prend alors un virage nostalgique grâce au travail de Taras Bychko. L’artiste originaire de Lviv déploie une série de photographies de rue aux tons chaleureux, aux couleurs saturées et aux textures granulées dont seule la photographie argentique détient le secret.
Out of Time (Hors du temps, 2018) présente des scénettes de la vie quotidienne, dérobées dans les rues et les commerces des grandes villes du pays. Une enfant remplit une bouteille d’eau devant un camion tout droit sorti des années 1970. Une femme patiente chez le coiffeur, devant un mur à la peinture délavée, la tête logée dans un casque de séchage de la même époque. Enfin, une silhouette traverse une rue du centre de Lviv dans la hâte, pour éviter un tramway dont les lignes rappellent ceux de San Francisco.
La date de prise de vue est confuse. Quelques objets parsemés dans le cadre trahissent notre siècle, mais ces clichés semblent provenir d’un autre temps, comme figés dans une époque révolue. Tout dans les décors, les personnes représentées à l’image, l’architecture des bâtiments respire l’anachronisme et porte encore les traces de l’influence soviétique. Entretenu par la technique employée et l’habileté du photographe à convoquer une esthétique passée, presque réconfortante, ce flou temporel témoigne des contrastes économiques et technologiques qui marquent encore l’Ukraine. Malgré les bouleversements culturels qu’il a connu et l’ouverture au capitalisme au début des années 1990, le pays conserve encore aujourd’hui de nombreux artefacts antérieurs à cette époque. Ce phénomène se reflète justement dans le travail de Taras Bychko.


Feintant l’architecture brutaliste et fonctionnelle des grands ensembles soviétiques, les colombiers de Kiyv, compilés dans la série de Oleksander Navrotskiy, tombent aujourd’hui en désuétude et sont laissés à l’abandon. Les photographies en noir et blanc donnent à voir ces édifices sous toutes leurs formes. Ils occupent généralement le centre du cadre et détonnent avec le fond de l’image tapissé d’immeubles en béton. D’aucuns diront que l’intérêt de l’œuvre est limité, que les qualités plastiques de Dovecotes (2019-2022) sont loin de transcender les canons de beauté et que la série peut sembler répétitive. Mais d’autres choisiront d’y voir une allégorie du peuple ukrainien ayant fui son foyer, en attendant que le calme regagne les rues de Kiyv. Là réside toute la force de l’œuvre.

Le foyer, justement, est au cœur de ce second acte. Régulièrement soumise aux déplacements et aux déportations, la population ukrainienne a connu de nombreuses privations de son propre foyer. Alina Sutko porte un regard empathique et intimiste sur les victimes de persécutions en Crimée. Le portrait de cette femme tenant son enfant, au regard fuyant l’objectif et à qui l’on a retiré son mari, cristallise un déchirement collectif à tous ses pairs. Si le style d’Alina Sutko baigne dans la sobriété, que l’image conserve des tons naturels et n’est quasiment pas soumise à la retouche, New Hybrid Deportation (2016-2019) montre avec finesse les vies chamboulées par les persécutions russes sur les minorités ukrainiennes.

La troisième et plus riche partie de Paysage présage se concentre sur un pressentiment transversal au travail des différents artistes qu’elle intègre. Chacune des séries exposées traduit un besoin de documenter les paysages, urbains et naturels, encore préservés de la guerre. La subtilité intervient lorsque l’on regarde ces différentes photographies avec un œil attentif. Nombre d’entre elles pourraient également avoir été produites ces dix derniers mois. À ce moment précis, l’exposition redouble d’épaisseur. Chacune des photographies peut être scrutée avec attention pour déceler des détails qui en changeraient complètement la perception, suivant le contexte de visionnage.
Kharkiv (2009-2011), présentée par le collectif Shilo (Sergiy Lebedynskyy et Vladyslav Krasnoshchok), entretient parfaitement ce doute. Réalisés à partir de techniques de photographies anciennes, ces tirages en épreuves gélatino-argentiques (un des plus anciens procédés chimiques d’enregistrement de l’image argentique) sont maculés d’un grain épais qui fond les corps et les objets dans la masse de décors offerts par les rues de Kharkiv.

Les noirs profonds, les imperfections liées au procédé de fixation de la photo, le flou récurrent instaurent une atmosphère sinistre et un sentiment d’urgence. Kharkiv semble déjà plongée dans la guerre. Sur une des photographies, un homme s’enfuit, son chien dans les bras, pour échapper à un éclair. Le ciel tourmenté qui se dresse derrière lui semble déjà chargé de cendres, alors qu’il ne s’agit que d’un orage.
Sur une autre image, les rues de la ville sont vides, comme si elles avaient été désertées à l’approche des combats. Enfin, vient cette photographie d’un homme maigre faisant mine d’être intimidant. Chaque image interprète à sa façon la grammaire visuelle du reportage de guerre, alors que cette dernière n’était pas encore aux portes de la ville. La démarche artistique est puissante, l’effet produit l’est encore plus.

Paysage présage révèle une anxiété latente, retrouvée dans toutes les images, comme si, au fond, tout le monde savait que la catastrophe était proche, malgré le déni des politiques et d’une partie de la population. Les manœuvres militaires, la présence d’arsenal et d’infrastructures fondus dans l’environnement naturel documentées dans la série Location classified (2017-2019) de Mykhaylo Palichak laissent entrevoir des bribes de cette anxiété. La déflagration d’une bombe dans un bassin, représentée dans un très grand format occupant un pan de mur entier, montre que l’Ukraine se préparait, à raison et dans le secret, à toutes les éventualités

Malgré la diversité de techniques et de genres photographiques représentés, Paysage présage parvient à conserver une forte cohérence thématique. À travers cette série d’images capturées avant l’offensive russe, l’exposition reflète des sensibilités distinctes et la multiplicité d’attitudes qu’expriment les Ukrainiens et Ukrainiennes à l’égard de leur identité, leur histoire et leurs paysages. Elle invite à réfléchir à la manière dont la perception des œuvres, leur sens et, enfin, leur appréciation changent en fonction du contexte de visionnage. Paysage présage offre ainsi un regard unique sur un pays dont le visage sera à jamais changé par la guerre. Elle est d’importance capitale.

Dans un courrier daté du 28 novembre révélé par les DNA, et que Rue89 Strasbourg a pu consulter, la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, estime que la délibération adoptée par le conseil municipal de Strasbourg le 26 septembre pour encadrer toutes les subventions en faveur des cultes est « entachée d’illégalités manifestes ». Dans le cadre de son contrôle de légalité, la préfète demande à la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian (EE-LV), de « procéder par une nouvelle délibération du conseil municipal et dans les meilleurs délais, au retrait de ladite délibération ». Difficile de faire plus sec.
Cette délibération-cadre visait à mettre toutes les religions sur un pied d’égalité, un même taux de subventionnement et un plafonnement à un million d’euros. Elle avait été adoptée suite à une large concertation après le psychodrame de la subvention de 2,5 million d’euros accordée à la mosquée Eyyub Sultan de la Meinau, un bâtiment gigantesque surtout motivé par les rêves de grandeur du Millî Görus, une organisation islamique conservatrice d’origine turque.
Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
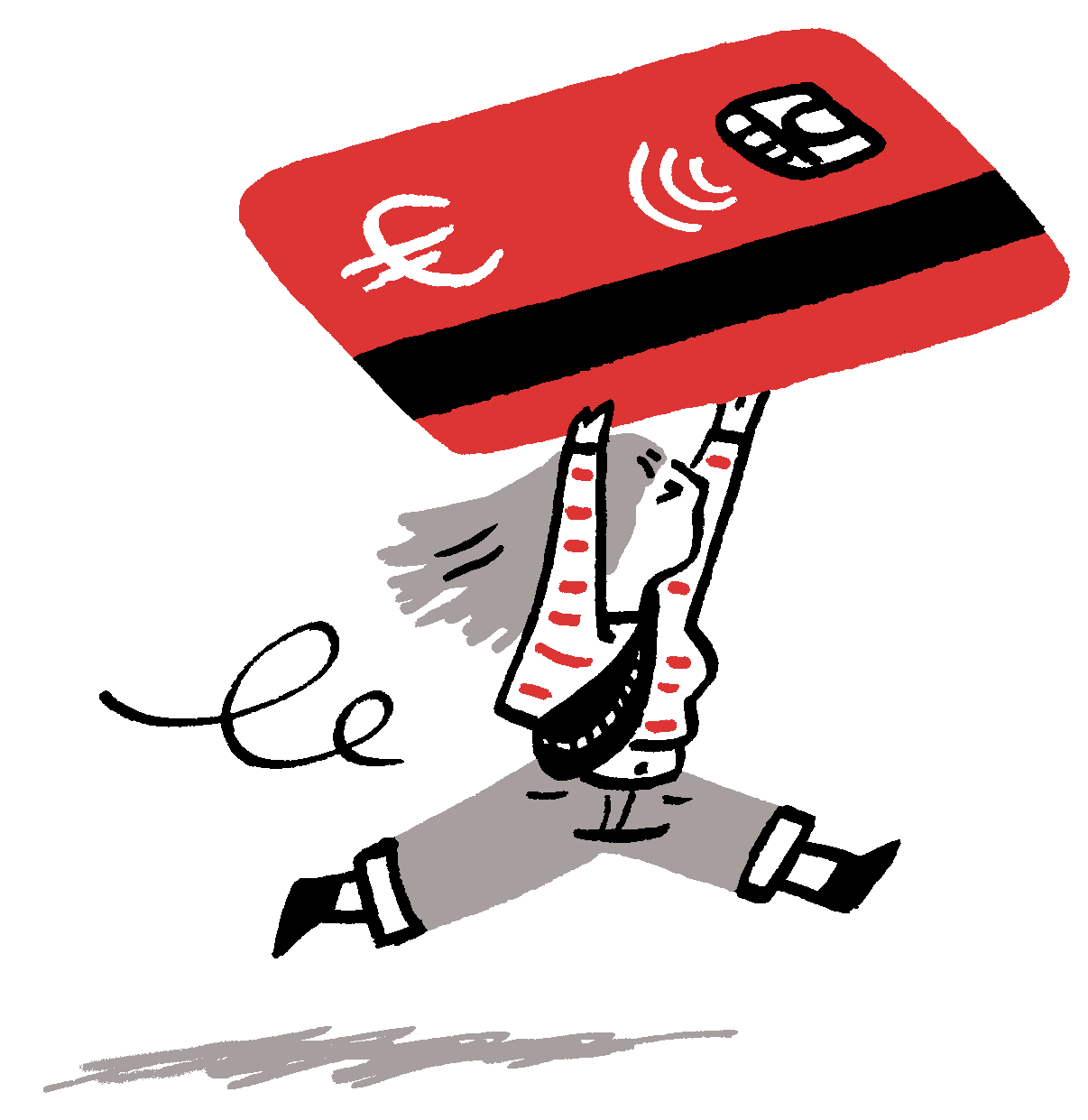
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Qui se souvient de Wikileaks et de son fondateur Julian Assange ? Lancée en 2006, la plate-forme a publié des documents bancaires ou judiciaires mais elle est surtout connue pour avoir publié en 2010 les « war logs », une série de rapports de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan. Depuis cette date, Julian Assange est pourchassé par la justice américaine, qui réclame son extradition du Royaume-Uni où il est emprisonné.
Cette histoire a ému Sahra Datoussaid, comédienne et dramaturge, et Sarah Siré, comédienne et metteuse en scène. Les deux bruxelloises ont créé Assange Odysseia, un objet théâtral entre le documentaire et le tribunal, afin de définir de quoi la tragédie de Julian Assange est révélatrice :
« Nous avons constaté que son histoire tombait dans l’oubli voire s’évaporait dans l’image d’une figure controversée. Il nous semblait pourtant qu’elle interrogeait les limites de nos démocraties. Grâce à Wikileaks, les secrets d’État pouvant être qualifiés de crime de guerre, de torture et de corruption sont parvenus à la connaissance de toutes et tous. Et pourtant ce travail “d’historien du présent” a privé Julian Assange de sa liberté. »
La séance publique de ce « théâtre forum » ou « théâtre documentaire » est prévue mardi 24 janvier au Théâtre national de Strasbourg tandis que trois sessions de préparation publiques également sont programmées vendredi 9 et samedi 10 décembre au théâtre TJP. Il s’agit d’y réfléchir sur le cas de Julian Assange et à la manière de le raconter au public.
Renaud Herbin, directeur du théâtre TJP, détaille :
« Il y a un symbole fort de programmer cette odyssée à Strasbourg, siège de la Cour européenne des droits de l’Homme. On espère que des citoyens se mobiliseront puisqu’il faut discuter la forme finale que prendra le spectacle, la mise en scène, etc. »
Sahra Datoussaid et Sarah Siré ont déjà intégré plusieurs experts dans la construction de la narration, dont Françoise Tulkens par exemple, juge à la CEDH de 1998 à 2012, ou Rafael Correa, l’ancien président de l’Équateur, qui a accordé l’asile de son ambassade à Londres à Julian Assange, Amnesty international, des juristes pour démêler la saga judiciaire et des journalistes. Leur travail s’inscrit aussi dans les pas de Milo Rau, dramaturge et essayiste suisse, créateur du tribunal d’opinion sur le Congo.

Depuis janvier 2022, les bouteilles Fischer ont déserté les ateliers de la maison d’arrêt de Strasbourg. Pendant plusieurs années, des prisonniers strasbourgeois ont travaillé chaque jour pour installer la fermeture mécanique emblématique de ces bières au bouchon couvert du petit Hans. Puis le groupe Heineken a décidé d’opter pour la capsule métallique sur les bières Fischer. C’est ainsi que 22 postes de travail ont été perdus dans la prison strasbourgeoise. Ainsi qu’en témoigne un responsable syndical du personnel de la prison qui a préféré garder l’anonymat :
« Il y a 20 ans, il y avait une centaine de détenus qui travaillaient dans les ateliers. Les surveillants faisaient venir des petites boites grâce à leur relation avec ces entreprises. Puis la gestion des ateliers est passée à une entreprise privée. Maintenant ils sont à peine 60 à pouvoir travailler aux ateliers. »

Selon nos informations, les principaux pourvoyeurs d’emplois en détention strasbourgeoise sont aujourd’hui les entreprises Würth, Cartonnages d’Alsace ou Éco-idée. À cela s’ajoutent les détenus qui travaillent pour la prison. Ils sont par exemple auxiliaires pour le nettoyage ou la distribution des repas. La tendance est clairement à la baisse du travail pour des entreprises privées en prison. En 2015, à la maison d’arrêt de Strasbourg, ils étaient 90 détenus à travailler dans les ateliers.
À la maison d’arrêt de Strasbourg, le travail est une denrée rare. Avec une soixantaine de postes pour plus de 650 détenus, il est accessible à moins de 10% de la population carcérale. Les détenus et anciens prisonniers interviewés pour cette série « Parole aux taulards » en témoignent. « Ils te donnent jamais de retour pour ton inscription au travail en maison d’arrêt, regrette Valentin, moi on m’a interdit le travail au cours de plusieurs incarcérations pour des propos insultants à l’égard d’une surveillante. » Achraf confirme : « J’ai demandé à travailler. Mais je n’ai jamais eu de réponse. Quand j’ai fait ma dixième requête, ça faisait un an et demi que j’étais sur la liste d’attente. »

Pour Sofiane, il est évident qu’un détenu strasbourgeois n’obtient un poste de travail que par la corruption. Il en témoigne, de sa propre expérience :
« On peut rendre un service à un surveillant par exemple. Ça arrive que les surveillants utilisent un détenu pour faire chier un autre détenu. Certains surveillants demandent de frapper un détenu parce qu’ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Moi, le travail d’auxiliaire qu’ils m’ont donné, pour toutes les peines que j’ai faites, j’ai eu le taff par un piston. »
Jacques connait ce pistonnage. Il a attendu huit mois pour obtenir un poste de travail aux ateliers de la maison d’arrêt de Strasbourg : « Pendant ces huit mois d’attente, j’ai vu des détenus arriver en détention et commencer tout de suite à bosser. » Il a ensuite travaillé pendant plusieurs années au sein de la prison strasbourgeoise :
« J’ai été chef d’équipe. Je sais que les embauches ne se font pas en commission. Elles se font par le bouche à oreille, entre le contremaître et les détenus. Selon la charge de travail, on passe de huit à 25 employés. Quand il y avait un besoin urgent en personnel. On prenait n’importe qui qu’on connaissait, sans regarder la liste d’attente. »
Sans proche pour l’aider financièrement, Jacques a besoin de ce salaire pour améliorer son quotidien en prison : « Je gagnais 1 400 euros bruts par mois, pour un travail de 7h30 à 13 heures tous les jours de la semaine. On faisait l’emballage pour des produits Würth. La paye me permettait de cantiner du café, les aliments du petit-déjeuner, un peu de viande et un peu de pâtes… »
Puis Jacques a perdu son poste. Il parle d’une dénonciation calomnieuse d’un travailleur de l’atelier sans donner de précision, de crainte d’être reconnu dans son témoignage. « Depuis cette décision de m’écarter de l’atelier, je n’ai plus aucun revenu. On vit avec 20 euros par mois. Dans cette situation, impossible d’acheter à manger. Les contacts avec mes enfants sont aussi réduits parce que la cabine téléphonique coûte extrêmement cher, sur un portable 18 centimes par minute, 8 centimes sur un fixe. » Comme l’indique la section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) :
« L’accès au téléphone (en cabine, et depuis peu, en cellule dans une poignée d’établissements) est très onéreux en prison : jusqu’à 110 euros par mois pour 20 minutes d’appel quotidien vers des portables (vers l’étranger ou les collectivités d’outre-mer, un seul appel de 20 minutes sur un fixe peut atteindre 25 euros). »

Cette perte de revenu constitue une autre source d’angoisse pour Jacques. Comme tout détenu, il espère obtenir une remise de peine. Or cette sortie anticipée de la détention dépend des commissions Réduction de Peine Supplémentaire (RPS), comme l’explique le détenu strasbourgeois : « Sans salaire, je ne peux plus payer les parties civiles. J’ai plusieurs milliers d’euros de dommages et intérêts à payer. Si je ne peux pas le faire, c’est pris en compte par la commission qui ne me donnera pas de remise de peine… »
Avec la réforme du code pénitentiaire appliquée depuis mai 2022, le travail en prison a été profondément réformé. Ce changement donne plus de droits aux détenus, comme l’explique Thierry Kuhn, directeur d’Emmaus Mundo et acteur de cette réforme qu’il défend comme « un moyen de sécuriser la sortie avec une vraie activité, la plus proche du contrat de travail, avec un salaire horaire fixe (les détenus étaient souvent payés à la pièce produite, NDLR), un droit à la formation et aux congés… » Du côté de la directrice du centre de détention d’Oermingen, connu pour son taux d’emploi record (70% des détenus y travaillent), on exprimait plutôt l’inquiétude de voir les concessionnaires quitter l’établissement. À la maison d’arrêt de Strasbourg, pour l’instant, aucune entreprise n’a cessé son activité en lien avec cette réforme.

À partir de ce lundi 12 décembre, les usagers des transports en commun bas-rhinois découvriront le réseau express métropolitain européen (REME). « 800 trains supplémentaires par semaine, avec de plus grandes amplitudes et une intensification le week-end dès ce mois de décembre. En septembre 2023, on augmentera encore pour arriver à 1 000 trains en plus », résume Jean Rottner (LR), président de la Région Grand Est. L’élu haut-rhinois est fier de présenter le REME, « une première nationale », à Paris, à la Maison de l’Alsace ce mercredi 7 décembre. Le ministre des Transports Clément Beaune est présent pour l’occasion.
Le projet est issu d’une collaboration entre la Région et l’Eurométropole de Strasbourg, dont la présidente Pia Imbs (sans étiquette), rappelle les investissements des deux collectivités :
« Le REME, c’est 15 millions d’euros supplémentaires par an, répartis équitablement entre la Région et l’Eurométropole. Il répond à trois objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports, donner plus possibilités de déplacement alternatives à la voiture du fait de l’augmentation du prix du carburant, et améliorer la qualité de l’air à Strasbourg, en synergie avec la mise en place de la ZFE. »

Les élus locaux insistent : le REME concerne aussi les bus et les cars, dont la fréquence et la rapidité des lignes seront aussi augmentées. Un beau projet sur le papier, salué par le ministre et le P-DG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, qui participe aussi à l’événement, « un jour de fête », dit-il.

Pas sûr que les syndicats des cheminots apprécient, même si sur le principe, ils soutiennent le projet. Ils étaient en grève le 25 novembre pour dénoncer une augmentation des cadencements irréaliste et diffusaient un tract pour l’occasion, demandant « les moyens de travailler » :
« À l’heure actuelle, de nombreux trains sont supprimés. Prétendre augmenter le plan de transports alors que nous n’avons déjà pas les moyens de tenir la charge actuelle est une arnaque. […] Plus de retards, plus de suppressions, moins d’informations… C’est malheureusement à cela que risque de ressembler le REME 2023. »
Les associations d’usagers ASTUS et Bruche-Piémont Rail font la même observation : il manque du personnel et du matériel. Elles s’inquiètent aussi d’une dégradation quasi-automatique du service des TER au-delà de l’étoile strasbourgeoise, à cause d’une concentration des efforts localisée autour de l’Eurométropole. Interpellé sur ces sujets, Jean Rottner a concédé que des dysfonctionnements risquent d’avoir lieu au lancement : « Le rail, c’est du temps long, on travaille depuis quatre ans sur ce projet, et on a encore cinq ans de travail. »

Concernant le manque de moyens, le P-DG de la SNCF a rapidement répondu que sa société travaillait pour « résoudre ces problèmes de fond ». La direction de l’entreprise ferroviaire expliquait à France Bleu que 37 conducteurs ont été recrutés (sur 83 nécessaires pour le fonctionnement du REME) et seront opérationnels avant le 12 décembre, et que les cheminots d’autres régions et des retraités pourront aider. Pas évident, vu la pénurie générale de conducteurs de trains en France. La SNCF ne parvient plus à recruter suffisamment, dans un contexte où certains avantages des cheminots ont été supprimés par le gouvernement, alors que les horaires difficiles et les gros déplacements persistent.


Contribuez à consolider un média indépendant à Strasbourg, en capacité d’enquêter sur les enjeux locaux.
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine meurt sous les coups de policiers – les tristement fameux voltigeurs motorisés (ou PVM) – censés disperser des manifestations étudiantes à Paris. Malik, qui sortait d’une boîte de jazz et a été battu à mort dans le hall d’un immeuble, devient le symbole des violences policières et du racisme qui touchent les immigrés nord africains. « Plus jamais ça! », clament alors des milliers d’étudiants.
Le réalisateur Rachid Bouchareb souhaite revenir sur cette affaire que la jeunesse d’aujourd’hui ne connaît pas, mais aussi rappeler la mort d’un autre jeune Algérien, la même nuit : Abdel Benyahia. En montant en parallèle ces deux drames, il trace le portrait de deux familles qui n’ont pas les mêmes armes pour affronter la violence d’État, et met en lumière cette face très sombre de l’histoire de l’immigration en France. Combien de Malik, et combien d’Abdel morts et passés sous silence? questionne le réalisateur d’Indigènes et de Hors-la-loi.
Rue89 Strasbourg : Pourquoi parler de l’histoire de Malik Oussekine aujourd’hui ? Est-ce que cela a un rapport avec les manifestations des Gilets jaunes que vous citez à la fin du film ?
Rachid Bouchareb : Cela fait 25 ans que je veux faire ce film, mais je me devais d’en faire deux autres très importants pour moi avant : Indigènes et Hors-la-loi. Finalement, ces trois films racontent une histoire entre l’Algérie et la France sur 50 ans. La Seconde guerre mondiale avec Indigènes, la guerre d’Algérie avec Hors-la -loi, et la mort de Malik en 1986. Je cite les Gilets jaunes parce que Macron a réintroduit des unités de policiers à moto pour intervenir dans les manifestations, qui rappellent les voltigeurs des années 1980… On a le sentiment que rien n’avance. Mais je voulais raconter cette histoire de toutes façons.
Quelle importance a pris la mort de Malik Oussekine à l’époque dans votre vie?
J’avais 29 ans à l’époque et comme beaucoup de gens, j’ai été très touché par la mort de Malik. En tant que fils de parents immigrés, habitant dans ma banlieue parisienne, pas loin d’ailleurs de la famille d’Abdel Benyahia, je me sens forcément proche de qu’il se passe alors. Mais ce n’est pas un événement unique qui m’a marqué plus que les autres. Depuis la nuit du 17 octobre 1961 (manifestation parisienne en soutien au Front de Libération Nationale au cours de laquelle un nombre indéterminé d’immigrés algériens ont été tués par balle, frappés à mort ou jetés dans la Seine par la police, NDLR), c’était arrivé tellement de fois!

Pourquoi avoir centré votre film uniquement sur les trois jours autour de la mort de Malik et Abdel ?
J’aurais pu raconter le combat de ces deux familles durant des années pour obtenir justice, mais j’ai trouvé qu’il y avait déjà quelque chose de très intense sur ces 48 heures, avec les meurtres et l’attente des familles. Quand j’ai travaillé sur les archives, j’ai été emporté par tout ce qu’il se passe au niveau politique avec Chirac, Mitterrand, Pasqua etc. C’était très fort.
Les images d’archives se mêlent étroitement avec les images de fiction, parfois vous avez même filmé des acteurs aujourd’hui comme si c’était des archives. Vous vouliez créer une confusion ?
Non, je ne voulais pas créer de confusion sur les sources. Mais il fallait passer des archives à la fiction par glissement, pour ne pas qu’on sorte de l’histoire. Je ne voulais pas faire un docu-fiction, mais qu’on soit immergé. J’ai donc dû créer les images qu’il me manquait, aller là où les caméras n’entraient pas à l’époque, remplacer une caméra vidéo de la police, reconstruire des archives de mauvaise qualité.

La bande originale nous replonge instantanément dans les années 80. Quand vous mettez la Mano Negra sur des images de manifestations, j’ai l’impression que vous les voyez comme des enfants qui s’amusent, quand d’autres risquent leur vie du simple fait de leur origine, est-ce que c’est votre ressenti ?
Pas du tout, j’ai choisi la Mano Negra parce que j’adore ! Ce sont les hasards du cinéma de créer des associations, des impressions qu’on n’avait pas forcément imaginées. C’est comme la chanson de Warda qui accompagne l’arrivée des voltigeurs, c’est très étonnant : avec une chanson d’amour égyptienne, j’ai voulu élargir l’imaginaire et prendre un risque, mais on n’est jamais sûr que ça marche. Warda, c’est la diva algérienne des années 1950. C’est une grande chanteuse du monde arabe, comme Oum Kalthoum.
Est-ce que c’est un film qui a été difficile à financer ?
Pas du tout, il se trouve que les gens qui ont produit « Nos frangins » ont vécu cette histoire, ils étaient étudiants, dans la rue en 1986 et ils se sont montrés très enthousiastes pour faire ce film.

« Le problème, c’est qu’ils risquent de se retrouver au centre d’aide au retour de Bouxwiller, de le fuir puis de dormir à nouveau dans la rue à Strasbourg dans deux jours », dénonce Gabriel Cardoen, militant strasbourgeois pour les droits des réfugiés. En fin de matinée, au moins une vingtaine de sans-abris qui dormaient sous des tentes place de l’Étoile ont été effectivement conduits dans ce foyer situé à Bouxwiller, selon des comptages effectués par des militants et des associations. Ce dispositif situé à 45 km de Strasbourg a pour objectif de les accompagner jusqu’à un retour vers leur pays d’origine.

La nuit est encore noire mardi 6 décembre quand une quinzaine de fourgons de police et quelques véhicules légers se massent autour du campement érigé au pied du centre administratif de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. L’opération de démantèlement débute. Des agents de police réveillent les occupants de la place pour leur dire de préparer leurs affaires. Tout se déroule dans le calme.

Une première évacuation avait eu lieu juste avant le feu d’artifice du 14 juillet, mais une partie des personnes s’étaient réinstallées ensuite presqu’immédiatement. Pour cette opération, la préfecture a dû demander au tribunal d’ordonner à la municipalité de demander l’expulsion. La maire Jeanne Barseghian (EE-LV) ne le souhaitait pas, étant donné l’absence de dispositif de relogement pour toutes les personnes concernées.
À sa plus forte affluence, fin octobre, le site comptait 200 personnes dont 43 enfants et de nombreux malades, quasiment tous migrants, originaires de Géorgie, de Roumanie, de Macédoine ou encore d’Afghanistan. Mardi matin, ils ne sont plus que 45, réveillés par les forces de l’ordre qui secouent doucement les tentes, parfois vides. « Certaines familles sont dans des voitures, des cages d’escaliers, pour se protéger du froid », indique Nicolas Fuchs, de la délégation bas-rhinoise de Médecins du Monde qui assiste à l’événement :
« Ces deux dernières semaines, des familles avec enfants qui appelaient le 115 (numéro de téléphone pour demander un hébergement d’urgence, NDLR) ont été logées. C’est une bonne chose. »
Dès le départ, une quinzaine de membres du collectif D’ailleurs nous sommes d’ici (DNSI) sont présents pour témoigner de leur « solidarité envers les migrants ». D’autres soutiens arrivent peu à peu, ils seront une cinquantaine en tout, derrière un périmètre délimité par de la rubalise, avec notamment cinq élus communistes et le député LFI Emmanuel Fernandes.
Après avoir déposé leurs affaires en soute, les occupants du parc montent dans deux bus affrétés pour l’occasion, direction le gymnase Branly, réquisitionné par l’État, dans le quartier des Contades. Les services de la Ville de Strasbourg prennent ensuite le relais pour nettoyer la zone.

Selon Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture qui supervise l’opération, la majorité des personnes sont des hommes isolés. Quelques femmes, certaines plutôt âgées, entrent dans les cars. Leurs situations administratives seront examinées pour les répartir dans les dispositifs dédiés.
D’après un bilan des services de l’État, 11 primo-demandeurs d’asile bénéficieront d’une prise en charge de l’OFII. Ils seront probablement dirigés vers des Centres d’accueil des demandeurs d’asile (Cada). 13 étrangers avec des titres de séjour seront logés dans des hébergements d’urgence grâce au SIAO, la structure qui gère le « 115 ». Et 23 migrants en situation irrégulière seront amenés vers des « centres d’aide au retour ». Le cas d’une personne connue des services de police pour des troubles à l’ordre public n’est pas encore fixé.

Vers 7h30, toutes les tentes sont vides et les bus partis vers le gymnase Branly, agencé par la Protection civile qui a été mandatée par la préfecture. Devant cette salle de sport, une quinzaine de militants se rassemblent à nouveau. Certains d’entre eux sont en lien avec des personnes déplacées et se renseignent quant à leur destination finale.
Vers midi, tous les anciens occupants du parc ont quitté le gymnase. Au téléphone avec les sans-abris, Gabriel Cardoen apprend qu’au moins un bus avec vingt personnes est arrivé au centre d’aide au retour de l’État à Bouxwiller, une information confirmée par Médecins du Monde.
Gérard Baumgart, militant historique de la solidarité envers les migrants, distribue un texte qu’il a imprimé au nom du Collectif Étoile devant le gymnase :
« Nous demandons qu’une attention soit faite pour les personnes en fin de droits administratifs. L’État ne doit pas fracasser des vies et des destins en s’appuyant sur quelques textes réglementaires. Ces personnes nous ont confié vivre dans la terreur de retourner dans leur pays d’origine, d’où elles ont fui des menaces, des violences de toutes sortes. »

À Strasbourg, des centaines de personnes dorment toujours dehors dans de petits campements installés au bord des routes et des parcs, selon Jeanne Barseghian. Moins visibles, ils risquent bien d’accueillir prochainement d’anciens occupants de la place de l’Étoile, alors que les températures atteignent des niveaux difficilement supportables.

L’opération d’évacuation se termine, deux bus sont partis avec les occupants vers un gymnase de Strasbourg mobilisé pour l’occasion.
Présent également avec une partie de l’équipe strasbourgeoise, Nicolas Fuchs de Médecins du Monde déclare :
« Dans un premier temps, on espère que des évaluations médico-sociales seront effectuées avec des prises en charges adaptées aux besoins. Des personnes ici ont des pathologies lourdes. Lors de deux évaluations, on a constaté des cancers, diabètes, handicaps, des personnes à mobilité réduite et en fauteuil… Cette situation doit permettre à l’ensemble des acteurs, État, Ville, de se rassembler et trouver des solutions de fond. Chaque semaine, près de mille personnes appellent le 115 à Strasbourg, les besoins sont énormes et croissants. »

Puis il précise :
« On ne règle pas le problème de l’hébergement d’urgence aujourd’hui, juste la question sanitaire de la place de l’Étoile. On ne peut que constater que de nombreuses personnes ont quitté le site. Certaines familles sont dans des voitures, des cages d’escaliers… »
Selon Médecins du monde, un tiers des « ménages » présents étaient des familles avec enfants lors d’une évaluation menée le 15 novembre.

Présent sur le site, le député (LFI) Emmanuel Fernandes déclare :
« Ces gens ne sont pas là pour s’accaparer des richesses ou je ne sais pas quoi, ils sont dans une grande misère, fuient de graves persécutions. Ce camp est visible mais il ne faut pas oublier les autres. »
D’autres élus étaient présents, les quatre élus du groupe communiste de la Ville de Strasbourg, Hülliya Turan, Joris Castiglione, Yasmina Chadli, Aurélien Bonnarel et une élue communiste de la Collectivité d’Alsace, Fleur Laronze.
Selon M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, l’opération d’évacuation concerne une trentaine de personnes après un premier décompte. Il s’agit à 90% d’hommes isolés qui sont envoyés par bus vers un gymnase mobilisé par la Ville de Strasbourg.
Il s’agit peut-être du gymnase Branly mais cette précision n’est pas confirmée à ce stade.


Tonio Gomez demande un accueil digne des migrants :
« La mairie qui se dit de gauche doit s’allier avec les associations et créer un rapport de force pour loger les gens. Il y a des bâtiments vides. Il y a beaucoup de personnes ici qui pleurent à l’idée de rentrer dans leur pays. Il y a des histoires de mafia, de persécutions. On sait que la responsabilité est énorme du côté de la préfecture, mais en constatant ça, la mairie doit prendre ses responsabilités. »


Pour plus de justice sociale, elle ne lâche pas son combat contre l’évasion fiscale. Eurodéputée de la France insoumise et co-présidente du groupe de la Gauche Unitaire européenne (GUE) au Parlement européen, Manon Aubry a commencé à s’engager sur cette thématique au sein de l’organisation non gouvernementale Oxfam. Membre de la sous-commission dédiée à l’évasion fiscale au Parlement européen, elle sera au cinéma Star Saint-Exupéry lundi 12 décembre après la projection du film de Yannick Kergoat « La (très) grande évasion » à 20 heures. Interview.

Rue89 Strasbourg : vous vous êtes engagée très tôt contre l’évasion fiscale. D’où vous est venu cet engagement ?
Manon Aubry : Avant Oxfam, j’ai travaillé en République Démocratique du Congo (RDC) sur les pratiques fiscales des entreprises minières. La RDC, c’est un pays riche cobalt. Mais ça reste un pays pauvre, notamment parce que le système fiscal est injuste et qu’il ne permet pas à l’Etat de lever les taxes nécessaires à la redistribution des richesses.
Puis je suis rentrée en France et j’ai travaillé pour Oxfam à l’époque des révélations sur l’évasion fiscale comme les Panama Papers, les LuxLeaks etc. A chaque fois, cette situation est prise comme un fait, un acquis : les milliardaires et les multinationales ne payent pas leurs impôts. Pour moi, c’est un scandale. Vous ne pouvez pas réduire les inégalités sans redistribuer les richesses. Il faut donc s’intéresser à la question fiscale. Quand les plus riches se soustraient à leur obligation de payer des impôts, ça pose la question démocratique du consentement à l’impôt. Pourquoi payons-nous nos impôts alors que les plus riches n’en payent pas ?
Vous avez vu le film de Yannick Kergoat. Qu’en avez-vous pensé ?
Le film montre très bien l’impact de l’évasion fiscale sur notre vie quotidienne. Le braquage de l’hôpital à la fin, c’est une mise en scène d’Oxfam. Quand Total, Google, Amazon ou Bernard Arnault ne payent pas leurs impôts, c’est nos hôpitaux qui se retrouvent à l’agonie. Aujourd’hui, nos hôpitaux sont incapables de gérer la bronchiolite. C’est pourtant une maladie de base qui se gère quand on a le matériel nécessaire.
Le film explique aussi qu’on a volontairement voulu rendre complexe la question fiscale, pour que personne ne comprenne rien. Or, ce n’est pas une question technique, c’est une question politique. Est-ce qu’on met fin aux avantages fiscaux ? La question n’est pas si complexe que ça en réalité. Le problème n’est pas le manque de solution, c’est un problème politique. Et le film le montre bien sur la liste des paradis fiscaux. Comment peut-on dresser une liste tout en permettant à des États comme l’Irlande ou le Luxembourg de participer à la constitution de cette liste ?
Quel sentiment vous a donné ce film ?
Un sentiment de colère légitime, une colère que j’ai depuis des années puisque je travaille sur ce sujet depuis longtemps.
En même temps, j’ai eu le sentiment du chemin parcouru. Il y a une dizaine d’années, nous étions des lanceurs d’alerte sur l’évasion fiscale. En quelques années, c’est devenu une évidence que l’évasion est pratiquée à grande échelle et que nous ne sommes pas égaux face à l’évasion fiscale. C’est bien dit dans le film : l’évasion fiscale est un sport de riches et de multinationales, en particulier des entreprises je dirais.
Il y a enfin l’espoir qu’il y ait une prise de conscience globale sur l’évasion fiscale pour transformer cette prise de conscience en action politique. Concernant la transparence des multinationales, je travaille sur ce dossier depuis que j’ai travaillé chez Oxfam et maintenant en tant que députée européenne au Parlement. Récemment, des négociations au niveau européen ont abouti à une transparence limitée qui ne nous permet pas d’estimer ce que Total ou Google devrait payer comme impôt. On a découvert par la suite que la position de la France avait été rédigé à partir de la position du syndicat patronal Medef (grâce à des révélations du média Contexte, NDLR). C’est assez symptomatique des difficultés qu’on rencontre et de la collusion des intérêts économiques et des régulateurs. C’est comme si on demandait à Monsanto de réguler les OGM.
Le phénomène s’aggrave ou la politique parvient à réduire l’évasion fiscale ?
Dans la course à l’évasion fiscale, les États ont fini par se réveiller. Mais ils se mettent seulement à marcher quand les évadés fiscaux courent, beaucoup plus vite. Donc si vous regardez les actions des États, ils ont entrepris des choses, certes… mais l’écart pour rattraper les évadés fiscaux, lui, il grandit car les méthodes d’évasion se complexifient et se développent toujours plus vite.
La lutte contre l’évasion fiscale se joue avant tout au Parlement européen, selon vous ?
Clairement, l’échelon européen est le plus intéressant sur la fiscalité. Mais sur cette thématique de la fiscalité, il faut un vote unanime de tous les États-membres pour légiférer. Donc avec des États comme le Luxembourg, l’Irlande, Malte ou les Pays-Bas, difficile de faire évoluer le cadre législatif.
Avec la France insoumise et le groupe de la gauche européenne, on a toujours défendu l’idée d’être précurseur avec un impôt universel. Son principe serait de calculer l’impôt que devrait payer l’entreprise au niveau international et de reprendre la part française en fonction du nombre d’employés et du chiffre d’affaire national. L’idée est de le faire de manière unilatéral en tant que Français, pour ensuite inspirer des États voisins comme l’Espagne et l’Italie et pour finir par proposer une régulation européenne. La France est la deuxième économie européenne. Elle peut montrer la voie et aboutir à un changement qui serait acté à Strasbourg. D’autant qu’avec cette course à la concurrence fiscale, le taux d’imposition sera de 0% en 2050 au rythme où on va.
Que peuvent faire celles et ceux qui regarderont ce film ?
On peut agir à tous les niveaux. Ce film sort en partenariat avec Oxfam, Attac, la Ligue des Droits de l’Homme. Ces associations se battent au quotidien pour mettre l’évasion fiscale à l’agenda politique. On peut déjà soutenir ces associations ou s’y engager.
Personnellement, je ne rêvais pas de politique, mais on n’a pas trouvé d’autre manière de changer les règles fiscales que de prendre le pouvoir de changer des lois, pour voter l’impôt universel, il faut changer le code général des impôts… Ceux qui profitent de l’évasion fiscale, il n’attendent que le défaitisme et le renoncement des gens. Mais la Révolution de 1789 est née en partie sur une révolte fiscale, notamment le tiers État qui ne voulait plus payer la dime. L’injustice fiscale, et plus récemment les Giles jaunes, doivent structurer notre révolte et notre mobilisation. On est pas condamné à avoir des Total ou Arnault qui ne payent pas d’impôt. En étant nombreux, et grâce à ce film, je pense qu’on peut inverser la tendance.

Cette fois, plus de gants. Le conflit qui oppose la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, à la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, va occuper les juridictions. Une singulière escalade du dialogue institutionnel, alors qu’en 2020, face à la pandémie de covid-19, il était question de l’efficacité du « couple maire-préfet. »
Lundi matin lors d’une conférence de presse improvisée, Jeanne Barseghian a annoncé que la Ville de Strasbourg attaquerait l’État pour sa défaillance à héberger les personnes sans-abris. Devant les journalistes, la maire a réagi à l’ordonnance du tribunal administratif, notifiée vendredi, lui enjoignant de procéder à l’expulsion de la centaine d’occupants du parc de l’Étoile :
« Dans les grandes villes du Rhin supérieur, il n’y a pas de campement de sans-abris, car l’État fédéral et les länders mettent les moyens pour aider les villes, alors même que l’Allemagne a accueilli beaucoup plus de réfugiés que la France après les guerres en Syrie et en Ukraine. Donc ça suffit cette inaction de l’État qui bafoue les droits humains. J’appelle tous les élus et toutes les associations qui sont concernés par cette défaillance étatique à nous rejoindre dans cette procédure. »
Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
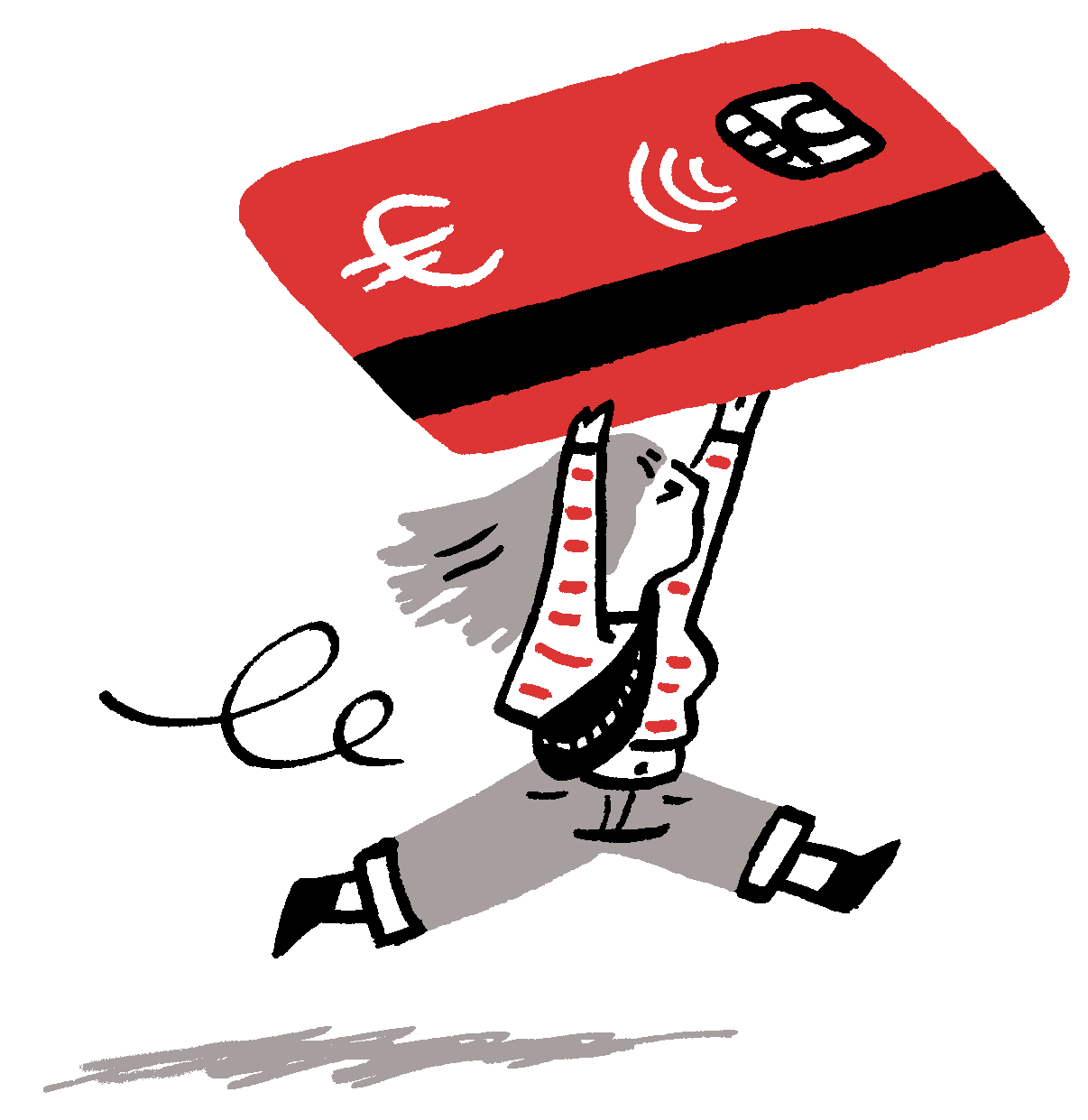
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
La municipalité a annoncé lundi 5 décembre qu’elle compte intenter « une action en responsabilité contre l’État pour inaction et carence en matière de mise à l’abri de personnes en grande précarité ». Elle appelle les autres communes de France à se joindre à l’action. « Si on avait une solution, de notre côté, on l’aurait mise en place », assure Jeanne Barseghian (EE-LV), maire de Strasbourg.

Depuis le printemps 2022, un grand campement de sans-abris est installé place de l’Étoile, devant le centre administratif de l’Eurométropole. Dans une ordonnance rendue vendredi 2 décembre, le tribunal administratif a demandé à la maire de Strasbourg de faire expulser le campement dans les trois jours en demandant le concours des services de la préfecture et de la police nationale.

La Ville s’est conformée à la décision de justice et a sollicité, dans la journée du vendredi 2 décembre, l’aide des services de l’État. Lundi matin, troisième jour après l’ordonnance, Jeanne Barseghian indique que l’heure exacte de l’intervention n’est pas connue : « Nous sommes d’accord sur le fait que c’est problématique de laisser les personnes dans le doute. Mais c’est la préfecture qui va lancer l’opération. » De son côté, la préfète a annoncé lundi matin accorder le concours de la force publique pour l’évacuation de la place de l’Étoile. La préfecture demande à la municipalité de « procéder à l’enlèvement des tentes et au nettoyage de l’espace public » après l’évacuation.
La maire déplore que l’État ne donne pas de solution d’hébergement à ces personnes, quasiment toutes migrantes, alors qu’il y est obligé en théorie : « Un démantèlement sans mise à l’abri ensuite n’est pas souhaitable. C’est l’intérêt des personnes qui nous importe. » La préfecture dit systématiquement « donner des solutions en fonction des situations administratives ».
Plusieurs fois, suite à des expulsions de camp ces derniers mois, les demandeurs d’asile en fin de droit administratif ont été acheminés vers un foyer à Bouxwiller qui vise à les inciter à retourner dans leur pays d’origine. Suite à l’expulsion pour tirer le feu d’artifice du 14 juillet depuis la place, le camp s’était reformé car de nombreux sans-abris avaient quitté ce centre « d’aide au retour » pour retourner à Strasbourg.
Jeanne Barseghian rappelle qu’il y a « des centaines d’autres personnes dans la rue à Strasbourg, moins visibles ». Floriane Varieras, adjointe à la maire en charge de la Solidarité estime que ce lundi, entre 40 et 50 personnes vivent sur le camp. Fin octobre, 200 personnes y étaient installées. La maire expose :
« Emmanuel Macron avait annoncé pendant sa campagne de 2017 qu’il n’y aurait plus de sans-abris en France quelques mois après sa prise de fonction. On s’interroge vraiment sur le décalage entre ces annonces et la réalité du terrain, avec un État qui ne met pas à l’abri de très nombreuses personnes à Strasbourg. »
Le collectif D’ailleurs nous sommes d’ici, qui vient régulièrement en aide aux sans-abris du camp de l’Étoile, demande à la Ville de Strasbourg d’éviter le scénario où les personnes se retrouvent à nouveau dans la rue suite à une expulsion, ou sont envoyées à Bouxwiller : « La Ville devrait trouver un hébergement, même précaire. » Selon Floriane Varieras, la mise à disposition d’un bâtiment municipal pose le même problème : « Il faut que les personnes soient encadrées sur place, et c’est aussi du ressort de la préfecture. Nous lui avons fait des propositions avec des bâtiments et n’avons pas eu de retour pour l’instant. »

Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous