Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture
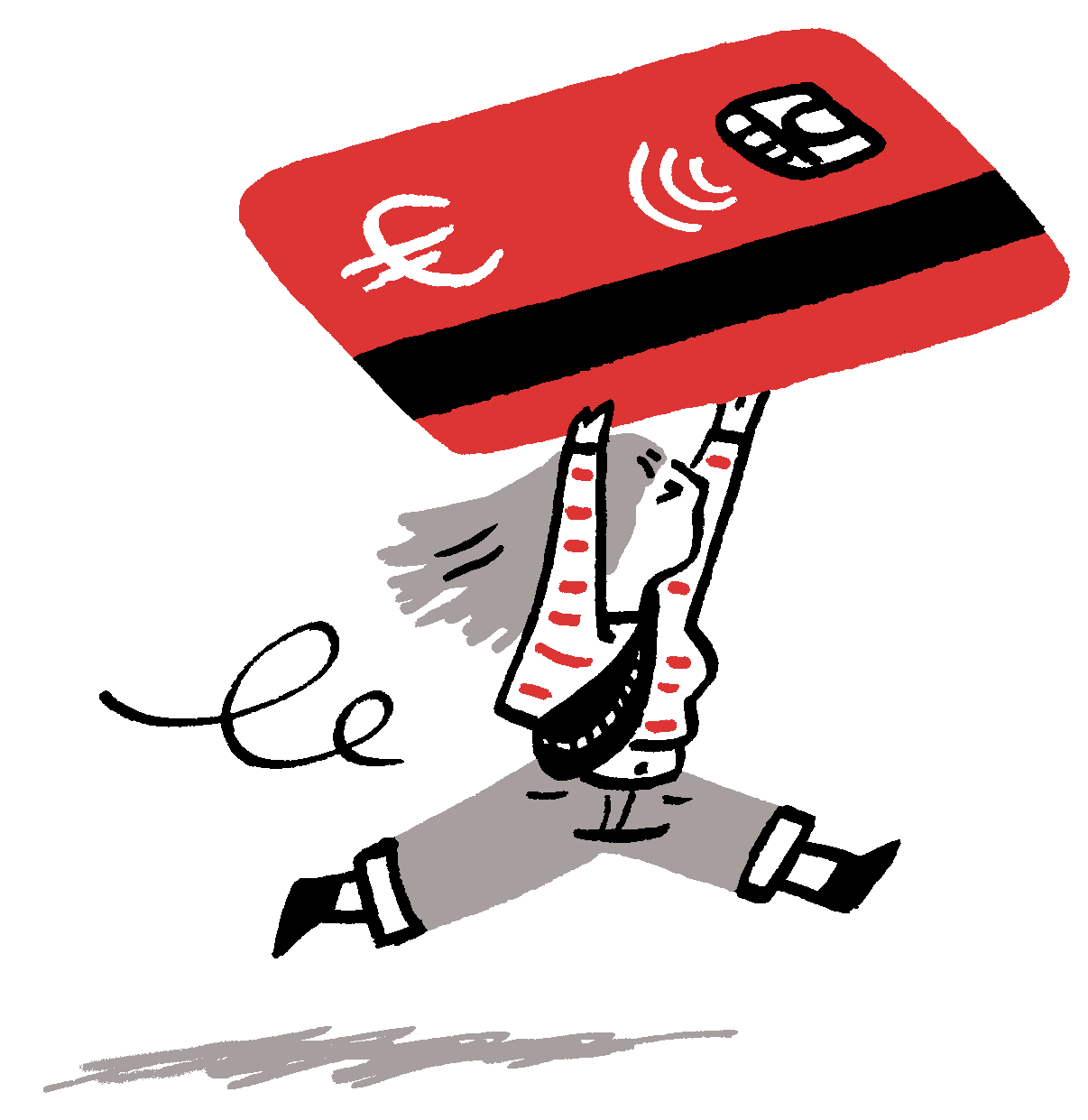
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
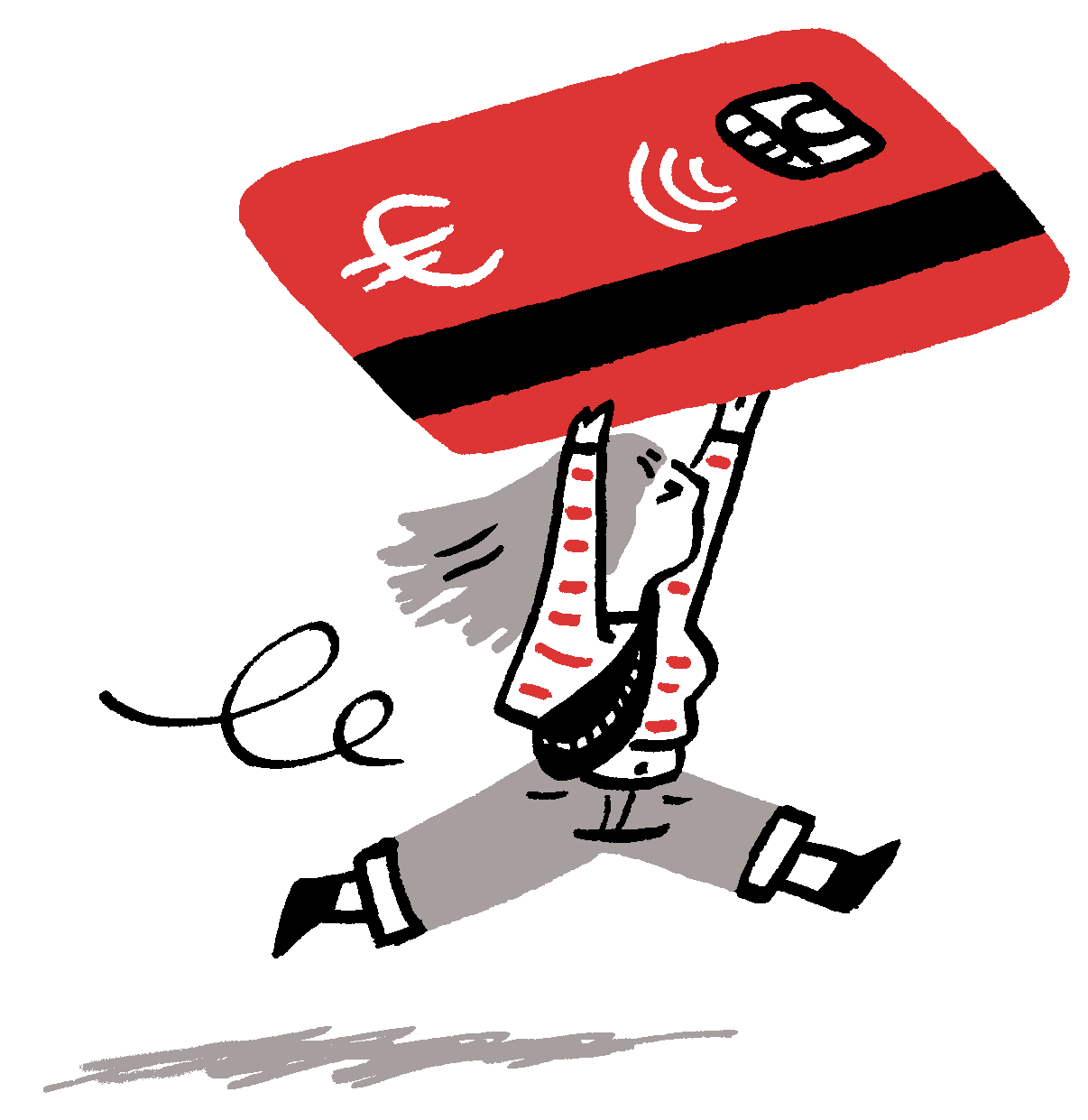
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Un kiosque à seringues à l’entrée de l’Elsau. Ce dispositif a été inauguré par la Ville de Strasbourg vendredi 1er juillet. Il fournit aux toxicomanes du matériel d’injection neuf, avec tout le nécessaire pour se droguer sans risquer de contracter une infection de type hépatite C ou VIH. La machine grise, située à l’angle des rues de la Montagne-Verte et des Imprimeurs, s’active lorsque l’on y insère un petit jeton. Ce dernier s’obtient soit en rendant une seringue usagée dans le « Distribox », soit en se rendant dans les locaux des associations de réduction des risques comme Ithaque ou l’Association lutte toxicomanie ou à la salle de consommation à moindre risque.
Adjoint à la maire en charge de la Santé, le médecin et addictologue Alexandre Feltz précise la vision de la municipalité écologiste :
« En France, la consommation de drogues est toujours illégale et les usagers sont toujours considérés comme des personnes malades. Nous préférons parler de personnes fragiles. Avec ce kiosque, il s’agit d’être au plus près des lieux de consommation à Strasbourg. Il s’agit aussi d’offrir du matériel neuf même la nuit et même pour ceux qui n’osent pas en demander en pharmacie. »
À quelques mètres, Lucie fait la promotion de la Distribox. Elle bénéficie du dispositif Tapaj, qui aide les jeunes confrontés à des problématiques d’addiction à se resocialiser à travers le travail. Crête rouge et côtés rasés, vêtue d’un blouson en cuir noir, elle exprime l’intérêt d’un tel dispositif :
« Les usagers auront moins de chance d’avoir des maladies. Mais ce sera aussi une bonne chose pour les habitants puisque les usagers sont incités à ne pas jeter leur seringues par terre afin d’en obtenir des neuves. »

« Face aux détracteurs, on explique que plus on sera en relation avec les usagers, plus on sera en capacité de résoudre les problèmes liés à la toxicomanie. »
Christophe Bronn, responsable de l’OPI Arsea à l’Elsau
Responsable de l’équipe de protection de l’enfance OPI Arsea à l’Elsau, Christophe Bronn travaille au quotidien avec les Elsauviens. Il estime que ce dispositif sera bien accueilli dans le quartier :
« Il y a eu des réunions pour expliquer tout le dispositif aux habitants. Les habitants de la rue de l’Oberelsau subissaient la consommation de drogues et trouvaient des seringues dans leur jardin. Aujourd’hui ils sont contents de voir qu’une solution est apportée. Face aux détracteurs, on explique que plus on sera en relation avec les usagers, plus on sera en capacité de résoudre les problèmes liés à la toxicomanie. »
Au même endroit, un camping-car d’Ithaque stationne depuis plusieurs années les lundis et vendredis soirs pour sensibiliser les usagers et leur distribuer du matériel d’injection. « Le kiosque à seringues, c’est un outil parmi d’autres. Ithaque met aussi en place un travail de rue pour rencontrer les usagers et les inciter à se rendre à la salle de consommation à moindre risque », ajoute Gauthier Waeckerlé, directeur d’Ithaque. L’association distribue sur l’Eurométropole de Strasbourg 250 000 kits d’injection chaque année (près de 700 par jour).

Ouverte en 2016, la salle de consommation à moindre risque Argos a placé Strasbourg à l’avant-garde des politiques de réduction des risques. Avec Paris, c’était alors la seule ville française à mettre en place une telle structure où l’usage de produits illicites était autorisé. Alexandre Feltz tient à se démarquer encore plus :
« Le dispositif strasbourgeois est le seul vrai modèle, puisqu’il est adapté au territoire de l’Eurométropole. Ce qui n’est pas le cas de la salle de Paris qui est sous-dimensionnée. »
Cinq ans plus tard, Argos s’est doté de 20 places d’hébergement inconditionnelles. Les usagers peuvent en bénéficier tout en pouvant consommer sur place. Ils peuvent aussi venir avec leur chien. Alexandre Feltz précise le caractère inédit de cette expérimentation :
« L’un de mes patients a entamé ici, de sa propre initiative, un traitement de substitution à la méthadone. Pour beaucoup d’usagers, la salle de consommation est un premier pas vers un parcours de soin ou de réinsertion sociale. »

Les premiers toxicomanes hébergés à l’étage de la salle de shoot sont arrivés en juin 2021. Un an plus tard, la structure a logé temporairement 23 personnes dont quatre femmes sur une durée moyenne de six mois. La moitié des personnes accueillies vivaient dans la rue avant d’être prises en charge par Ithaque.
Cette dernière recense 2 675 actes infirmiers réalisés (pansements, prises de sang, délivrances de traitements ou entretiens infirmiers) en un an, 214 entretiens avec un psychologue, psychiatre ou médecin ou 21 orientations vers un traitement de substitution à la méthadone. « 1 892 entretiens sociaux ont été réalisés », indique une brochure d’Ithaque, dont 220 entretiens pour la recherche de logement, 30 entretiens d’aide pour obtenir un papier d’identité ou 33 domiciliations postales.

Le chef du service en charge de l’hébergement, Jean Suss, estime qu’un bilan reste encore prématuré :
« C’est encore un espace d’expérimentation. Ce sera plus intéressant quand le dispositif aura trois ans. On découvre encore des besoins, comme un lieu pour les usagers vieillissants ainsi qu’un accompagnement pour les addictions lourdes à l’alcool ou au tabac. Il y a aussi des difficultés pour que les usagers aient accès à un logement après avoir été hébergés chez nous… »
La salle de consommation et l’hébergement ont nécessité plus de deux millions d’euros d’investissement, majoritairement financés par l’Agence régionale de santé (ARS) et la Ville de Strasbourg. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Ithaque et l’Eurodistrict font aussi partie des financeurs.

Pour fonctionner, la salle de consommation et l’hébergement ont besoin de l’équivalent de 35 personnes à temps plein : infirmiers, travailleurs sociaux, agents de médiation et autres médecins ou psychologues. Le budget de fonctionnement de la structure est de 1,25 million d’euros par an, pris en charge à parts égales entre l’ARS et la Caisse nationale d’assurance maladie.

« La première réussite, c’est l’extension de la dérogation qui permet l’hébergement et la salle de consommation à moindre risque jusqu’en 2025 », se félicite Alexandre Feltz, qui remercie l’ancien ministre de la Santé Olivier Véran, , à l’origine de cette prolongation. Le docteur Feltz se montre bien plus critique du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, lequel aurait « bloqué l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque à Lille ». Elle devait ouvrir en octobre 2021.

Une résolution sur la « taxonomie européenne des investissements durables » doit être votée mercredi 6 juillet au Parlement Européen, réuni en session plénière à Strasbourg. Au programme notamment, l’étiquetage du gaz et de l’énergie nucléaire par l’Union Européenne, s’agit-il d’énergies écologiques ou non ? Deux manifestations sont prévues à Strasbourg par « Les voix du nucléaire », mardi et mercredi, pour soutenir cette résolution tandis deux manifestations sont organisées mardi et mercredi par plusieurs associations anti-nucléaire pour s’opposer à ce vote.

La taxonomie européenne représente un enjeu crucial. Elle permet d’orienter des investissements vers des activités vertes, qui ont un impact positif pour l’environnement. Pour être qualifiée de durable, l’activité doit correspondre à au moins l’un des objectifs suivants : atténuer le changement climatique ou s’y adapter, utiliser durablement ou protéger les ressources aquatiques et marines, contribuer à la transition vers une économie circulaire, contrôler la pollution ou encore protéger la biodiversité ou les écosystèmes, selon l’Union européenne.
Le règlement « Taxonomie » a été adopté en 2020 par l’Union européenne pour plus de 90 activités économiques. Lors de sa création, les spécialistes avaient exclu de leurs recommandations le gaz et le nucléaire. Deux ans plus tard, la Commission européenne propose ce nouvel acte, afin d’y intégrer ces deux énergies. Pour l’institution, elles ont un « rôle à jouer pour faciliter le passage aux énergies renouvelables » et à « la neutralité climatique ». Un objectif en vue : la neutralité carbone en 2050.
Concrètement, si le texte est adopté, les investissements dans les centrales nucléaires pourraient être classés comme durables, à condition de présenter des garanties pour le traitement des déchets et le démantèlement des installations.
Louis Thomas, porte-parole de l’association « Les voix du nucléaire » précise son regret de voir les deux énergies, gaz et nucléaire, combinés dans un même texte. Mais l’association soutient malgré tout l’adoption de ce texte.
« L’énergie nucléaire représente le seul moyen de décarboner la production d’énergie de l’Union européenne, et s’opposer à cet acte favorisera le gaz naturel au lieu de le décourager. »
Louis Thomas, porte-parole Les voix du nucléaire

Côté opposants au nucléaire, plusieurs associations nationales, dont le Réseau Sortir du nucléaire, appellent à une manifestation à Strasbourg dont le départ est prévu mardi 5 juillet à midi de la place de l’Université. Un peu avant, le mouvement politique Diem25 prévoit de sensibiliser le public aux dangers de l’énergie nucléaire, avec bidons de déchets toxiques et combinaisons de protection.
Mercredi 6 juillet dès 8h, les opposants au nucléaire prévoient de « réveiller » les parlementaires européen en organisant une « chaîne humaine » devant le bâtiment strasbourgeois. Les partisans de cette énergie seront également présents avec des objectifs opposés.
Par arrêté du lundi 4 juillet, la préfecture a interdit toutes manifestations, cortèges et défilés les mardi 5 et mercredi 6 juillet de 8h à 19h autour du Parlement européen (voir le périmètre indiqué en rouge ci-dessous). Des « palpations de sécurité, inspections visuelle et fouilles des bagages » seront mises en place aux accès à ce périmètre (indiqués en vert sur la carte ci-dessous).

Suite au remaniement du gouvernement, il y aura à nouveau un ministre alsacien. Député de Mulhouse et ses environs, Olivier Becht va intégrer le deuxième gouvernement d’Elisabeth Borne. Il sera en charge du Commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger en tant que ministre délégué. Un statut intermédiaire, puisqu’Olivier Becht sera sous l’autorité de Catherine Colonna, la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. À la fin du mandat précédent, Brigitte Klinkert avait également ce titre de ministre déléguée, mais elle s’occupait de l’Insertion.
En juin, Olivier Becht avait été largement réélu député (64,63%), avec une abstention de plus de 60% dans sa circonscription. Mais malgré cette nette victoire aux élections législatives, l’ancien maire de Rixheim était en quelque sorte rentré dans le rang.

Élu sous la bannière « Les Républicains » en 2017 face à une candidate LREM, il avait vite rejoint la majorité présidentielle, via le nouveau parti de centre-droit Agir (comme Fabienne Keller ou Antoine Herth en Alsace). Olivier Becht avait accédé au titre de président de ce groupe d’appoint (22 députés) de la majorité d’Emmanuel Macron. Or, ce parti n’a désormais plus assez de député pour constituer un groupe séparé, contrairement à Horizons ou au Modem. Olivier Becht a ainsi rejoint le grand groupe de « Renaissance » (172 députés), le nouveau nom de LREM. En tant que ministre délégué, il succède à Franck Riester, également membre du parti Agir.
Comme d’autres élus haut-rhinois, il incarne la « macronisation » progressive de la droite alsacienne qui a permis à la coalition « Ensemble » d’obtenir 11 députés sur 15 en Alsace, bien mieux qu’en 2017 dans un contexte plus favorable. Dans les deux circonscriptions de Mulhouse, la ville de Jean Rottner (le président LR de la Région Grand Est), les candidats de la droite et du centre y ont réalisé des scores faméliques (5,41% et 4,34%).
Olivier Becht a été camarade de promotion d’Emmanuel Macron à l’ENA entre 2002 et 2004. Sa suppléante Charlotte Goetschy-Bolognese, 32 ans et conseillère municipale à Brunstatt-Didenheim, deviendra députée tant qu’Olivier Becht est au gouvernement.

« À Mulhouse, on ne pourra bientôt plus consulter un médecin librement. C’est catastrophique. » Le docteur Patrick Vogt, médecin généraliste dans le quartier périphérique Bel-Air, observe avec dépit et depuis plusieurs années la ville haut-rhinoise se vider de ses médecins. Lui-même a 66 ans :
« Nous sommes dans le creux de la vague pour les 10 ans à venir. Comme les généralistes sont vieillissants, nous allons assister à une pénurie totale. »
Depuis 2012, 27 médecins généralistes sont partis (d’après le rapport 2020 de l’Observatoire régional de la santé (ORS) Grand Est). Aujourd’hui, ils sont 52% à avoir plus de 55 ans. En 2015, ils étaient 61%, et l’observatoire relevait la fragilité de l’offre de soins comme un « point de vigilance ».
Mulhouse ne peut pas encore être qualifiée de « désert médical » selon l’Agence Régionale de Santé : avec 123 médecins pour 100 000 habitants, sa densité médicale est supérieure à celle de la France (89). Selon ce même rapport, cette densité médicale s’élève à 144 à Strasbourg. Mais l’observatoire lui-même pointe que ce chiffre s’élèverait plutôt à 83 à Mulhouse, car une partie des 123 exercent une activité de médecin spécialisé : régulateur, angiologue, ostéopathe… D’autre part, les habitants n’arrivent plus, dans les faits, à accéder à un médecin.
« Je suis en errance de médecin traitant depuis quatre ans », explique Pascale, 58 ans, habitante du centre-ville : « Depuis que notre médecin de famille est partie à la retraite, nous allons chez un praticien qui est un des seuls de son quartier, qui est désorganisé et assailli de très nombreux patients ». « Un soir j’avais rendez-vous à 20h, et quand je suis arrivé, il y avait 12 personnes devant moi », renchérit Hervé, son mari, retraité. D’où leur besoin de trouver un autre praticien, surtout pour les semi-urgences.
Quand leur fils a dû transmettre un arrêt maladie au lycée, ils se sont rendus à la nouvelle maison de santé Guillaume Tell, ouverte au centre-ville en 2019. Quatre médecins généralistes y sont installés. Tous les jours, la matinée est dédiée aux arrivées sans rendez-vous. Ce qui a permis à la petite famille d’obtenir un certificat médical le jour-même pour justifier de l’absence du lycéen. « Mais ça, c’était il y a deux ans », nuance Hervé. « Depuis, les gens se sont « refilés le bon plan, et il faut se battre pour avoir une consultation ».
En janvier 2022, se rendant un lundi à 9h dans cette petite rue presque confidentielle, Pascale s’est vue gentiment renvoyée chez elle. « La secrétaire s’est excusée, elle m’a dit qu’il y avait trois heures d’attente », se rappelle-t-elle. Prenant ses précautions quelques semaines plus tard, Hervé s’y est rendu à 7h05 et s’est retrouvé avec déjà 12 personnes devant lui. Il est reparti et a fini par obtenir une consultation en se postant un matin à 6h40 devant les portes… Il était alors en deuxième position dans la queue. « Ce ne sont pas des conditions pour aller chez le médecin ! », s’indigne Pascale.
À force, en venant très tôt le matin, Hervé a réussi à voir un même praticien, trois fois de suite, à la maison de santé. Celui-ci a accepté de devenir son médecin traitant, notamment pour suivre son affection longue durée.
« En fait, il faut faire du forcing. »
Hervé, Mulhousien retraité
Pascale, elle, reste parmi les 8 000 Mulhousiens de 17 ans et plus qui sont sans médecin traitant. Selon l’ORS, c’est 9,4% des patients, un chiffre moins élevé que dans le reste de la France mais plus important que la moyenne du Haut-Rhin et du Grand Est. Pascale jette l’éponge et « songe à trouver un médecin traitant sur Strasbourg », où elle travaille : « Ce sera presque plus simple. »

À Mulhouse, les patients sont tout simplement trop nombreux à demander des soins, alors même que l’offre est plutôt élevée, d’après le rapport 2020 de l’ORS. On y lit que les Mulhousiens sont plus malades qu’ailleurs : « Tous les ans, 94,1% de la population a recours à des médecins généralistes, contre 82,1% en France. Le nombre d’actes est plus élevé : on compte 5,1 actes par bénéficiaire (contre 4,6 en France) ».
Le rapport fait état de la situation sanitaire des Mulhousiens plus précaire que la moyenne française dans une infographie qui relève un plus fort taux de maladies chroniques et une espérance de vie moindre :
Alors, comment font les Mulhousiens avec ces salles d’attente qui débordent ? Dominique, chargé de mission dans le public, qui souffre de plusieurs affections longue durée, a recours à la « démerde » :
« Mon médecin est parti à la retraite. Il me voyait les samedis, car mon job m’oblige à être en déplacement la semaine. Je me tourne vers les copains, des pharmaciens qui m’aident à obtenir les médicaments mensuels. Et mon cousin cardiologue me suit pour mon cœur. »
Et pour ceux qui n’ont pas de médecins dans leur entourage ? Patrick Vogt alerte sur la situation critique des quartiers populaires :
« Deux médecins de la rue Lefebvre (dans le secteur Vauban-Neppert, un quartier populaire en profonde mutation vers un éco-quartier, ndlr) s’apprêtent à partir. Ce sera 4 000 à 5 000 personnes sur le carreau. Au Drouot, quartier prioritaire de la ville, il n’y aura bientôt plus de praticien du tout. »

Même à Riedisheim, une commune moyenne bordant Mulhouse au sud-est, Élise, une mère de famille, dit qu’elle « part perdante » quand elle a besoin d’un médecin. Elle se prépare au départ à la retraite de son docteur, chez qui elle ne va de toute façon quasiment plus : « Il faut une semaine ou plus pour obtenir un rendez-vous, ça ne sert plus à rien ».
Quand elle est malade, elle va en pharmacie demander des médicaments, ou… à la maison médicale de garde, qui n’est ouverte que les week-ends (elle est installée depuis 2018 au bâtiment annulaire, près de la gare) : « J’avoue, j’y suis allée pour un mal de dos, j’ai attendu le dimanche et j’ai pu y voir un médecin adorable ».
« Ça arrive tout le temps », confirme Bakir Ider, le médecin généraliste fondateur de la maison de garde, qui se partage les week-ends avec de nombreux confrères et consœurs :
« Les gens viennent pour des maux bénins et quand je leur demande pourquoi ils viennent chez nous, ils me disent qu’ils n’ont tout simplement pas de médecin. »
En cas d’urgence, par exemple quand son fils « fait des chocs à cause de ses allergies », Élise se tourne vers SOS Médecins, et « tant pis s’il faut attendre et payer plus cher ». Mais ce service commence à devenir de moins en moins accessible : « Quand j’ai appelé il y a quelques mois, parce que j’étais aphone et qu’aucun généraliste ne pouvait me prendre, ils m’ont dit de « rappeler dans trois jours » », témoigne Pascale.
L’association de médecins réfute ce témoignage. Selon son président, le Dr Frédéric Tryniszewski, SOS Médecin dédie en permanence 10 médecins :
« Nous sommes parfois saturés et dans ce cas, les appelants sont invités par un message vocal à rappeler plus tard. Mais quand on décroche, on ne reporte jamais la réponse à trois jours plus tard. »
Selon l’ORS, les appels à SOS Médecins ont augmenté de 32% depuis 2011, et proviennent principalement des quartiers prioritaires. Mais au quartier Nordfeld, qui n’est pas un quartier prioritaire, c’est devenu tout aussi compliqué. Dominique, une habitante, a appelé SOS Médecins un samedi matin pour sa mère âgée, « ils n’ont jamais répondu ». Alors que l’infirmière qui rend quotidiennement visite à sa mère dans sa résidence soupçonnait un zona, Dominique avait passé « 2h40 montre en main » à chercher un généraliste.
Désespérée, elle avait appelé le 15 mais « le régulateur m’a dit d’emmener ma mère aux urgences, mais j’ai refusé de la faire attendre 10 heures sur un brancard ». Dominique avait finit par obtenir, d’un ami d’ami, une ordonnance pour les bons médicaments. Elle déplore ce désert du samedi matin à Mulhouse, quand la maison médicale de garde n’est pas encore ouverte (elle ouvre l’après-midi) et que SOS Médecins relève du mirage.

Pour les semi-urgences ou douleurs non létales mais très inconfortables, c’est donc très difficile de se soigner pour certains Mulhousiens. À noter qu’en semaine, la maison de santé Guillaume Tell assure des consultations supplémentaires « en cas d’urgence », le soir de 18h à 20h.
Ceux qui ont encore un médecin s’y accrochent. Catherine Mock, médecin généraliste à orientation homéopathique, a pris sa retraite en 2019, et se rappelle de « nombreux patients qui ont pleuré » quand elle leur a annoncé son départ :
« Ils savaient qu’ils ne retrouveraient pas facilement quelqu’un. Certains n’en ont toujours pas trouvé d’ailleurs, notamment les personnes âgées avec un gros dossier et nécessitant un suivi important. Plus personne ne veut d’elles. »
« J’ai 5 à 10 appels par jour de gens qui me demandent d’être leur médecin traitant », signale de son côté Bakir Ider. « Je leur dis que je ne peux pas, que je ne peux plus ». Le jeune quadra fonctionne avec des consultations sans rendez-vous, il n’a pas d’horaires limites, « pour voir toutes les personnes qui viennent dans [s]a salle d’attente ». Tout comme Patrick Vogt, lequel explique n’avoir pris que « 15 jours de vacances en deux ans » et terminer « à pas d’heure » pour voir tout le monde.
De plus, l’affluence a « changé la pratique des médecins », estiment les patients, comme Dominique :
« Ils ne prennent plus le temps de nous examiner ou de prendre la tension. C’est 10 minutes par patient, top chrono. »
Cédric, habitant de Kingersheim, s’est senti très mal accueilli quand il s’est rendu chez un médecin du quartier des Coteaux, le seul disponible via l’application de rendez-vous médicaux Doctolib pour tout Mulhouse au début du mois de mai :
« Je n’avais pas vu de médecin depuis 4 ans, j’avais une plaie à la jambe et des maux de dos. Quand j’ai voulu également lui parler de mon surpoids, il m’a dit : “Je reçois pour une pathologie, pas 3 ou 4”. Ça faisait 8 minutes que j’étais là. Je n’y retournerai plus, mais je ne sais pas où j’irai. »

Pour les docteurs Vogt et Ider, mais aussi pour Simon Zielinski, à la tête de la Pharmacie Aux Lys au centre-ville, la solution résiderait dans l’arrivée de jeunes médecins. Un vœu pieu pour l’instant : « les jeunes docteurs restent à Strasbourg où il y a les facs », regrette le pharmacien :
« Aussi, leur pratique a changé : ils ne veulent plus s’installer seuls, ils veulent un certain confort, le bon coin de la ville, la patientèle sympa… Je pense aussi que certains ne s’installent pas dans les quartiers car ils ne veulent pas “faire du social” et se retrouver avec un patient sur dix qui n’a pas sa carte vitale à jour. »
Bakir Ider accuse le numerus clausus (le nombre maximal annuel de futurs médecins, NDLR), qui a fait baisser le nombre de médecins en activité. « Avant, on formait 8 000 médecins par an. Puis ça n’a fait que baisser depuis les années 80 et 90 », déplore-t-il (en 1993, les places en études de médecine se limitaient à 3 500, ndlr). Ce numerus clausus ayant été rehaussé (jusqu’à 9 000 en 2019) puis supprimé, le nombre de médecins en France devrait peu à peu remonter.
Patrick Vogt, lui, comprend la jeune génération qui refuse de subir « les contraintes terribles du métier » : « Ils ne veulent pas bosser 50 heures et ils tiennent à leur vie de famille, mais personne ne les écoute. » Pour lui, la balle est entre les mains des autorités et de l’ARS pour rendre le territoire accueillant :
« J’ai déjà interpellé la municipalité. Je leur dis : proposez des habitats corrects, des crèches, des zones d’accueil pour doctorants, et pour d’autres professions que des médecins, pour que ça bouge ! »

L’Agence régionale de santé propose cependant des aides incitatives pour l’installation de nouveaux médecins à Mulhouse, explique Pierre Lespinasse, délégué territorial de l’ARS dans le Haut-Rhin :
« L’assurance maladie propose des aides à l’installation, ce qui permet de lever tous les freins et d’aider à investir et de démarrer. Nous proposons également des aides financières pour les médecins qui s’installent dans des zones d’intervention prioritaire (ZIP) ou dans les zones d’action complémentaire. »
Les ZIP sont les territoires où les habitants ont accès à moins de 2,5 consultations par an et les territoires « fragiles » (entre 2,5 et 4 consultations par habitant et par an). Les ZAC sont des territoires un peu mieux lotis, qui « nécessitent de mettre en œuvre des moyens pour éviter que la situation ne se détériore », selon le zonage de l’ARS. Mulhouse est une ZAC depuis 2020. Elle ne l’était pas encore lors du zonage précédent de l’ARS, en 2018.
De son côté, la municipalité pourrait favoriser l’installation de maisons de santé et d’établissements pluridisciplinaires pour offrir de meilleures conditions de travail. Mais la Ville n’a pas souhaité répondre aux questions de Rue89 Strasbourg pour préciser ses intentions dans ce domaine.

La collection des scientifiques primés de l’Université de Strasbourg s’étoffe. Le généticien Jean-Louis Mandel, né à Strasbourg en 1946 et qui a fait l’essentiel de sa carrière à l’Unistra, vient de recevoir le prix Kavli, un prix presque aussi prestigieux que le prix Nobel mais pour les sciences. Ils sont onze à l’avoir reçu en 2022, dont quatre en neurosciences. Jean-Louis Mandel est le seul français.
Il a été récompensé pour ses travaux sur le « X fragile », une mutation dans un gène du chromosome X qui provoque une forme héréditaire de déficience intellectuelle. Avec son équipe, il a mis en évidence à partir de 1991, après huit ans de recherches, qu’une série de répétitions perturbait un gène, impactant le fonctionnement du cerveau. Ce qu’il ne savait pas à l’époque, c’est que cette méthode allait s’avérer utile pour la détection et la compréhension d’une cinquantaine de maladies génétiques rares.
Jean-Louis Mandel a été un discret professeur de génétique de la faculté de médecine de l’Unistra, jusqu’à sa nomination au Collège de France. Il a aussi été directeur de l’IGBMC (Institut de génétique, biologie moléculaire et de cellulaire), un centre de recherche de l’Université de Strasbourg et du CNRS situé à Illkirch-Graffenstaden.
Rencontré dans sa maison du vieux Schiltigheim, Jean-Louis Mandel détaille pour Rue89 Strasbourg ce qui l’anime aujourd’hui, les maladies génétiques et l’agilité de la recherche française.
Rue89 Strasbourg : Pourquoi la Fondation Kavli vous a remis leur prix, et pourquoi si tard ?
Jean-Louis Mandel : Lorsque j’ai pris ma retraite, mon prix le plus prestigieux était le prix Louis-Jeantet de médecine que j’ai obtenu en 1999. Quand l’Académie des sciences norvégienne m’a contacté et demandé de transmettre des éléments pour le prix Kavli, je pensais n’avoir aucune chance, je me disais qu’étant à la retraite, ma période de prix était un peu passée… Mais bon, comme je n’ai jamais vraiment arrêté de travailler, j’ai répondu aux demandes qui étaient à chaque fois un peu plus précises… Jusqu’à ce que je sois finalement sélectionné, même si c’est 30 ans après ces fameuses recherches. Avec mon équipe, j’ai eu beaucoup de chance en fait, car quand nous nous sommes lancés sur le « X fragile », c’était pour comprendre l’origine d’une maladie génétique rare… Nous ne soupçonnions pas à l’époque que nous allions découvrir toute une méthode. C’est peut-être ce que la Fondation Kavli a voulu honorer, j’ai le sentiment qu’elle a voulu saluer une découverte plutôt qu’une carrière.
Vous êtes à la retraite et pourtant toujours très actif. À quoi ressemblent vos journées ?
Je n’ai en fait jamais vraiment arrêté. Je ne vais plus sur les plateaux techniques bien sûr mais je travaille plusieurs heures tous les jours sur mon ordinateur, je lis des revues scientifiques, je participe à des congrès, j’écris des articles… J’envoie aussi beaucoup de mails.
Par exemple, j’essaie de faire progresser les applications thérapeutiques de la génétique… En janvier 2020, je me suis bagarré avec Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, pour faire avancer ce sujet. Pendant deux heures, j’ai parlé avec Jacques Bigot quand il était sénateur (PS) afin de proposer un amendement que la ministre a immédiatement bloqué…
Considérez-vous que les chercheurs devraient plus participer au débat public ?
À part quelques chercheurs médiatiques comme Axel Kahn, qui savent parler dans les médias, les chercheurs sont assez réservés en général. Pour ma part, j’ai signé des tribunes sur mes domaines de compétence quand on m’a sollicité. Mais c’est vrai que je suis resté assez discret. Sur la recherche en génétique, j’ai quand même participé à des commissions parlementaires, envoyé des notes, coécrit une tribune dans Le Monde sur le dépistage néonatal… Bon, je dois dire que si je dois faire le bilan de cette participation au débat public sur la génétique, c’est assez nul. On écoute les chercheurs mais on ne les entend pas.
Je trouve qu’on attend trop de l’État dans notre pays. En France, quand on parle d’application de la génétique dans la population générale, on attend une loi qui va décrire exactement ce qu’on a le droit de faire ou pas dans une totale opacité. On ne sait pas qui signe les décrets et s’il faut les modifier, il faudra attendre six ou sept ans que le Parlement se saisisse à nouveau de la génétique. Aux États-Unis sur cette question, il y a une commission, où chaque membre est identifié, qui publie des préconisations, qui sont soumises à débat critique, modifiées, etc.

Je pense qu’à peu près tous les scandales sanitaires qu’il y a eu en France, l’hormone de croissance, le distilbène, l’amiante, le Mediator… ont survenu parce que les décideurs n’ont pas tenu compte de ce que les chercheurs ont publié à l’étranger, comme si la France était une exception permanente.
Un autre scandale qui me tient à cœur et dont on parle peu, c’est la détection du déficit d’enzyme MCAD. Cette maladie provoque des crises d’hypoglycémie sévères, pouvant aller jusqu’au décès sur des enfants de moins de cinq ans. Dès 2000, une technique de détection a été mise en point. En 2005, cette technique est mise en œuvre dans d’autres pays. En 2011, la Haute autorité de santé publie un pavé s’interrogeant s’il faut généraliser ce dépistage, ce qui permettrait selon ce rapport d’éviter cinq morts d’enfants chaque année, plus deux atteints de troubles neurologiques irréversibles… Donc à ce jour, on aurait pu éviter entre 50 et 75 morts d’enfants, depuis qu’on connait cette méthode de détection !
Est-ce que les conditions de la recherche aujourd’hui permettent de tels succès ?
Quand j’ai débuté, les conditions de recherche étaient excellentes. Je travaillais dans le laboratoire de Pierre Chambon, qui est devenu l’IGBMC ensuite. C’était un labo unique en France et en Europe quant aux moyens techniques disponibles. Et puis surtout, la recherche était moins chère à l’époque pas toujours pour de bonnes raisons. Par exemple, les bourses attribuées aux étudiants chercheurs ne payaient pas les charges sociales… Donc j’avais plus de collaborateurs de qualité, on avait aussi plus de techniciens.
Aujourd’hui, les équipements sont devenus très coûteux et deviennent obsolètes en cinq ans… En outre, il faut un technicien ou une ingénieure pour s’en occuper, sinon il ne fonctionne qu’au tiers de ses capacités.
En outre, la compétition est devenue plus féroce et il y a un cercle vicieux. Les financements vont d’abord aux laboratoires qui affichent de bonnes perspectives… Ce qui n’est pas évident dans la recherche. Et dans ce match à l’échelle européenne, voire mondiale, je constate quand je me déplace dans les congrès que le nombre d’équipes françaises est en diminution.
La France a pris beaucoup de retard dans le séquençage de l’ADN, sur les programmes de grandes cohortes… Et puis il y a de moins en moins de postes de recherche, qui se réservent par raréfaction aux chercheurs les plus en vue. En outre, la loi Sauvadet limite les CDD à six ans maximum. Résultat, l’Inserm par exemple se sépare de collaborateurs bien formés et efficaces sur leurs appareils à partir de quatre années d’ancienneté… pour être remplacés par des gens qui débarquent. Dans un programme dont je fais partie, il y a 95% de taux de rotation des personnels ! Comment voulez-vous avancer dans ces conditions ?
Un autre dispositif qui m’inquiète, c’est l’interdiction de poursuivre ses recherches dans un labo où on a fait sa thèse… soit-disant pour favoriser les croisements d’idées. Quand je regarde les prix Nobel à Strasbourg, Jean-Marie Lehn a fait son doctorat à Strasbourg et a été nommé professeur à 24 ans à Strasbourg, Jules Hoffmann pareil, Jean-Pierre Sauvage pareil… Pierre Chambon, qui a reçu des prix aussi prestigieux que le Nobel, a fait toute sa carrière à Strasbourg. Je suis pour que ça bouge dans la recherche, mais pourquoi en faire une obligation absolue ? Quand on recommence tout à zéro, c’est plus compliqué de progresser !
Quel va être votre avenir avec ce prix ?
Je ne m’attends pas à de grands changements. Déjà, l’argent du prix (250 000€) ira à la recherche à l’Université de Strasbourg. Je n’ai pas encore les détails mais c’est mon souhait en tout cas.

Une scène immense en pleine nature vosgienne avec en toile de fond les vallons du Chena, des bières à foison et servies à la minute par des bénévoles rôdés, de larges espaces dédiés aux rencontres et à la papote, c’est le mix du festival Décibulles. D’habitude calé mi-juillet, ce rendez-vous alsacien qui marque le début des vacances démarre un poil plus tôt cette année, du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet. Après une édition annulée et une édition étalée sur cinq jours, on devine qu’il s’agit là de l’empressement de la part de l’équipe du festival de pouvoir proposer à nouveau la formule complète.
Parmi les nouveautés de sa 28e édition, Décibulles annonce un espace dédié à des animations dans une ambiance de fête foraine déjantée, avec bowling et kermesse, et l’ouverture d’un cinquième bar, particulièrement consacré au service de « bières de caractère ou d’autres boissons originales. »
Côté musique, Décibulles a choisi la sécurité cette année, avec des artistes capables à eux-seuls de remplir les quelques 9 000 places disponibles chaque soir. Citons par exemple Parov Stelar (dimanche), qui emmène les foules sur toutes les scènes majeures grâce à ses mix d’electro-swing, ou en profitant de la tournée des Stranglers, ce groupe britannique presque cinquantenaire, survivant du punk et dont les titres phares, « Always the sun » ou « Golden brown », ont bercé des générations. Il y a cependant des pépites plus rares qui ponctuent le programme 2022.

La soirée de vendredi est probablement la plus hip hop de ce festival plutôt connu pour ses choix électro et rock. Les amateurs de rap attendront probablement le set de Niksa, dont la voix s’exprime rarement sans autotune. Ils pourront utilement patienter avec le rap branché quartiers du Strasbourgeois Larry (plusieurs fois évoqué sur Rue89 Strasbourg ici), et peut-être découvrir le flow nettement plus sophistiqué, mais plus intime aussi, du sélestadien Ruff.
La papesse belge d’un soul berceur Selah Sue est l’artiste la plus consensuelle de la soirée. Il faut dire qu’avec sa voix à la fois claire, chaloupée et puissante, elle est capable de faire l’unanimité dès qu’elle se trouve derrière un micro. Son dernier album comporte même des titres aux accents hip hop :
Mais le clou de la soirée, ce pourrait être le show de Vitalic, qui promet d’être particulièrement spectaculaire alors que l’artiste électro fête ses vingt ans de carrière. Le musicien est revenu à un style plus trash, plus hardcore, ses deux derniers albums proposent des sons plus industriels que les titres qui lui ont valu son succès populaire.
Attention grosse affluence attendue samedi soir ! Avec la programmation des Stranglers, Décibulles s’assure un public prêt à voyager sur 50 ans de musique rock. L’autre star de la soirée, c’est Wookid et son étonnante pop hypnotique. Wookid s’écoute très bien chez soi, mais c’est encore autre chose de constater la puissance de sa voix grave en concert. Et la soirée intègre aussi les talentueux musiciens de La Femme, dont le pop-rock français convainc tout le monde.
A noter ce soir là, la présence de Pales, excellent jeune groupe de post punk strasbourgeois. Pales se retrouve sur la grande scène après avoir remporté le tremplin Décibulles, ce qui n’est pas une surprise étant donné que le groupe accumule les victoires (sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges, finaliste du tremplin Rock’n’Folk), grâce à un style qui charrie son lot d’énergie, sans négliger les impératifs mélodiques. Clairement à découvrir samedi en se collant face à la scène. Tout l’air frais du vallon ne sera pas de trop pour oxygéner le public à ce moment-là.
Fin juillet, ce groupe enregistre (enfin) son premier album à La Turbine à Niefern, dans le nord du Bas-Rhin (lire notre article sur ce studio). Pales, qui s’autoproduit contre toute attente, cherche le soutien de ses premiers fans pour financer cet album, via la plateforme Kiss Kiss Bank Bank.
La journée du dimanche est très éclectique, mêlant dès 15h des signatures du reggae, du rap, de la pop et de l’electro. La tête d’affiche est évidemment Parov Stelar et son electro swing sur-entendu mais jamais déplaisant. Décibulles fait revenir les très festifs Dub Inc. et laisse une belle place à Entourloop, un groupe de reggae qui trompe la monotonie du genre par quelques pointes de hip hop.
Le groupe lauréat du tremplin Décibulles pour ce dimanche, c’est Maeva qui propose une pop soul détendue bien qu’un brin classique. Les amateurs du genre y retrouveront tous les codes du genre, parfaitement maîtrisés.
Les plus curieux rendront visite à Murman Tsuladze, un artiste dont les compositions allient des sonorités orientales traditionnelles avec des orchestrations actuelles. Le mélange fonctionne à nouveau et comme il se présente comme un groupe de « disco de la Mer noire », il peut être utile d’échapper pour un temps à la grande scène, voir si un dance floor se créée devant la petite…

Contrairement à 2017, aucun député d’Alsace n’accède à l’une des fonctions de premier plan de l’Assemblée nationale, telles une présidence de commission, de groupe, une vice-présidence de l’Assemblée ou un rôle de questeur… Les quinze députés alsaciens ont néanmoins trouvé leur point d’attache avec une répartition dans huit commissions permanentes, toutes présidées par des membres de la majorité (désormais relative) présidentielle. À l’exception de celle des Finances, remportée par l’Insoumis Éric Coquerel.
Députée de Strasbourg-centre, l’écologiste Sandra Regol siègera dans la commission des Lois. Lors d’un entretien au Club de la presse le 24 juin, elle avait assuré que c’est l’instance qu’elle visait. En tant que secrétaire générale adjointe d’EE-LV, la numéro 2 du parti a un regard d’ensemble sur les politiques et le programme de la Nupes et c’est ce côté transversal qui l’attire :
« C’est une commission avec beaucoup de travail, puisque la plupart des lois y sont discutées. C’est là où l’on traite de la vie de tous les jours et des libertés. »
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
Citiz France a lancé une levée de fonds avec le collectif « Les Licoornes« , avec comme objectif de lancer son service d’autopartage dans de nouvelles communes. Le réseau de coopératives d’autopartage, né à Strasbourg, espère obtenir au moins 25 000 euros de la part de particuliers avant mi-juillet.
Cette levée de fonds fonctionne comme une augmentation du capital social. Les personnes intéressées achètent des « parts sociales » de Citiz France, à 250€ la part, et peuvent dès lors participer aux grandes orientations de la coopérative en votant lors de l’assemblée générale. Une part équivaut à une voix. Si les parts sont gardées pendant cinq ans, elles ouvrent droit à une déduction fiscale de 25% de leur valeur.
Pour Citiz France, cette levée de fonds citoyenne va permettre d’orienter les futurs développements de la coopérative. Selon Jean-Baptiste Schmider, directeur de Citiz France, « les nouveaux sociétaires pourront définir les territoires prioritaires où ils veulent que l’entreprise s’implante. »
Aujourd’hui, le réseau Citiz national propose plus de 1 700 voitures dans 170 communes. L’objectif est d’arriver à 5 000 véhicules dans 500 communes d’ici fin 2026. La coopérative d’origine strasbourgeoise souhaite s’établir dans toutes les collectivités de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’en Île-de-France où elle absente. « Si une collectivité rurale veut proposer l’autopartage à ses habitants, nous pourrons répondre », affirme Jean-Baptiste Schmider.

« Les professionnels et les collectivités viennent quand vraiment un projet très précis et très concret sur leurs territoires, sur une levée des fonds comme celle-ci, il est difficile de les intéresser. On va les approcher dans un deuxième temps »., déclare le patron de Citiz.
La coopérative d’autopartage cherche à évoluer vers une solution globale aux besoins en mobilité. À Angers et Lyon, Citiz expérimente le partage de vélos cargos. Il reste à affiner le modèle économique et à sécuriser les véhicules sans rendre leur accès trop compliqué. Mais Jean-Baptiste Schmider l’annonce : « on pense que Strasbourg pourrait être une très belle ville pour développer le partage de vélos cargos ! »

Strasbourg possède une offre culturelle dense à travers des institutions fortes et installées, comme le Théâtre national de Strasbourg (TNS) ou l’Opéra du Rhin. Mais la scène émergente n’y est pas délaissée pour autant. De plus en plus d’espaces lui sont dédiés et de nombreux acteurs n’hésitent pas à prendre des risques pour découvrir les pépites de demain. Depuis février, La Pokop, une nouvelle salle de spectacle dédiée à la jeune création et co-gérée par le Crous et l’Université de Strasbourg a ouvert ses portes. Une fierté pour Juliette Lacladère-Baumgartner, responsable du service culturel du Crous de Strasbourg et membre du comité de direction de la salle :
« C’est un projet qui est dans les rouages depuis 2013, car nous avions identifié un réel besoin. Il y a 70 000 étudiants sur le campus et nous n’avions pas vraiment de lieu à proximité pour accueillir les créations des étudiants et des associations. Avec la Pokop, nous avons enfin une salle consacrée à la jeune création, pensée notamment pour accueillir les tremplins du Crous, mais aussi de jeunes troupes. »

Située au 19 rue du Jura, à quelques minutes du campus de l’Esplanade, cette nouvelle salle peut accueillir près de 500 spectateurs debout ou 204 assis. Elle remplace le gymnase Paul Collomp qui a été entièrement réaménagé dans le cadre du plan campus de rénovation.
« Un service du Crous dédié à la culture a été créé en décembre 2020. Avant, les missions culturelles étaient rattachées à un pôle englobant la communication et le marketing… », rappelle Juliette Lacladère-Baumgartner. La Pokop est une des seules salles de spectacle de France à être co-gérée par un Crouset une université.
Depuis son ouverture, la salle a déjà pu accueillir les finales régionales des tremplins de théâtre et de musique du Crous et la finale nationale de danse. Ces concours proposés aux étudiants leur donnent l’opportunité de se faire connaître, de remporter des contrats pour jouer dans des festivals ou d’obtenir des résidences de création. « Grâce à la nouvelle salle, nous pourrons accompagner non plus un, mais deux gagnants du tremplin théâtre à travers des résidences. L’une aura toujours lieu au TAPS et l’autre sera à La Pokop, » précise Juliette Lacladère-Baumgartner.

Côté musique, le tremplin Pulsation 2022 a notamment permis au jeune groupe Solid Champagne, constitué d’étudiants en licence de musicologie, de décrocher une scène pour le festival de la rentrée, Campus Alternatif et une résidence de pré-production scénique à l’Espace Django.
Cette salle est un autre lieu important de la scène émergente strasbourgeoise. « En tant que lieu culturel implanté dans le quartier du Neuhof, nous devons être attentifs à ce qu’il se passe sur notre territoire et encourager la pratique de l’art à tous les âges », présente Benoit Van Kote, co-directeur et programmateur de la structure. Avec son école de musique implantée dans ses locaux et les ateliers en milieu scolaire autour de la musique actuelle réalisées, l’équipe de Django cherche d’abord à éveiller des vocations.
Django programme aussi régulièrement de jeunes groupes en première partie, réserve des soirées entières à de nouveaux projets et accompagne certains d’entre eux dans le cadre de leur pépinière. Benoit Van Kote présente le projet :
« Nous avons créé ce dispositif d’accompagnement après un diagnostic de ce qui manquait à la scène locale pour se développer, c’est-à-dire un accompagnement plus structurant pour que les artistes aient une meilleure compréhension du milieu professionnel. Nous sélectionnons trois groupes, puis nous travaillons avec eux pendant deux ans, pour faire un travail de fond sur les volets entrepreneurial et artistique. »
À Strasbourg, plusieurs festivals dédient une partie, voire l’intégralité, de leur programmation à la scène émergente. C’est le cas de Démostratif, le festival des arts scéniques émergents qui investit, depuis 2018, le campus de l’Esplanade et qui s’est étendu en 2022 avec des spectacles à La Pokop, à la BNU ou encore à l’église Saint-Guillaume.
L’édition 2022, programmée par Sacha Vilmar, a mis à l’honneur la jeune autrice et dramaturge Anette Gillard. Diplômée de l’Université de Strasbourg, elle a été membre du Théâtre universitaire de Strasbourg en 2018 et enseigne à l’Unistra depuis 2021. À ses côtés, plus d’une trentaine d’autres artistes locaux et internationaux, dont le strasbourgeois Logan Person de la jeune compagnie Convergences. Il explique que ce festival lui permet de montrer au public une première partie de son travail :
« Je présente pour la première fois une lecture de la pièce que nous sommes en train de créer et qui revient sur l’histoire d’Iphigénie. C’est une étape de travail, mais, à un moment, il faut se jeter à l’eau et ce festival est une très belle occasion de se confronter et d’échanger une première fois avec des spectateurs. Démostratif offre un cadre bienveillant, inclusif et qui soutient les prises de risques, ce qui est très agréable. »
Ruby est aussi membre de la compagnie. Pour elles, Démostratif offre des pistes pour bien se lancer :
« Les échanges et le réseau sont très importants dans notre métier, notamment pour évoquer les questions plus administratives ou initier des partenariats. C’est top de pouvoir bénéficier de ce type de rendez-vous, avec des artistes d’ici, mais aussi d’ailleurs. Certains viennent de tout le pays et même du Burkina Faso ou du Canada ».

« Faire appel à des artistes amateurs, c’est faire un pari sur la fréquentation. Le public ne les connaissant pas, il peut ne pas vouloir prendre de risque même pour un festival gratuit », précise Sacha Vilmar. D’un autre côté, les jeunes artistes sont souvent moins chers à programmer que les vétérans.
Depuis plusieurs années, le Pelpass festival, qui a tenu sa 5e édition fin mai, mise sur sa capacité à surprendre son public et à lui faire découvrir de nouveaux artistes, comme l’explique son directeur artistique Jérémie Fallecker :
« C’est beau de voir des gens nous faire confiance et venir sans connaître aucun groupe de la programmation. Ils ne savent pas à quoi s’attendre, mais certains vont vivre un concert qui va les marquer. Des festivals comme le nôtre peuvent réellement servir de tremplin à des groupes encore tous neufs. »
Cette année, près 9 000 personnes ont assisté à la trentaine de concerts programmés au festival, ce qui conforte Jérémie Fallecker dans sa volonté de dénicher des talents encore peu connus :
« Réaliser une telle programmation prend du temps et demande beaucoup de travail de recherche. J’assiste à énormément de concerts, de festivals, je suis très à l’écoute de mon réseau pour voir quels artistes sort du lot. Beaucoup de groupes nous contactent également, parfois on reçoit 40 démos par jour et, malheureusement, nous n’arrivons pas à tout écouter. »

De nombreux lieux défendent désormais ce type de programmation, comme La Péniche mécanique, La Maison Bleue, La Grenze, qui rejoignent l’Espace Django ou le Molodoï.«
En relation plus ou moins étroite, les différentes structures tentent de fonctionner en bonne intelligence pour que l’offre soit diversifiée et la visibilité partagée. Par exemple, il n’y a pas eu d’autre gros événement en même temps que le Pelpass. Pour Benoit Van Kote, programmateur de Django qui a notamment participé au jury du tremplin musical du Crous ou du festival Décibulles, ce maillage gagnerait à s’organiser davantage :
« Il y a beaucoup de bons projets mais les groupes strasbourgeois ont parfois du mal à rayonner au-delà de la région. C’est notamment dû au fait qu’on manque d’entreprises de programmation, qui ont l’habitude de faire tourner les artistes à plus grande échelle. Par contre, nous avons beaucoup de structures de production. »
En partant de ce constat, différents acteurs veulent renforcer le rayonnement des artistes qu’ils accompagnent. Depuis trois saisons, l’Espace Django a rejoint le dispositif transfrontalier Iceberg, initié par les Eurockéennes et la fondation CMA suisse.

L’éducation aux médias par Rue89 Strasbourg, c’est avant tout permettre à des élèves de se saisir des outils journalistiques pour en comprendre les contraintes. Cette année scolaire 2021 / 2022, le collège Hans Arp a accepté de financer l’achat d’une vingtaine d’appareils photo jetables. L’objectif était de permettre à des adolescents de réaliser un photoreportage dans leur quartier (les collégiens viennent pour la plupart de l’Elsau ou du quartier de la Montagne Verte). Depuis fin avril, une sélection des photographies de la classe de 4ème G est exposée au centre de documentation et d’information (CDI) de l’établissement.

Avant de partir en reportage, les élèves de la « classe média » ont été invités à définir l’angle de leur reportage. Cette notion essentielle en journalisme peut se résumer à une question à laquelle on cherche à répondre. L’angle donne le cadre indispensable aux journalistes pour ne pas se perdre dans un sujet trop large. Voici quelques exemples de sujets choisis par les collégiens pour un travail sur leur quartier :
Très vite, les élèves ont compris l’intérêt de la photographie pour transmettre une information et répondre à leur question. Aylin et Nurelhuda ont ainsi photographié différents restaurants et autres pâtisseries de la Montagne Verte. Marouane et Evence se sont rendus dans les espaces verts de l’Elsau pour réaliser des portraits des usagers du parc, entre promenade du chien, petit footing et bagarre. Guillaume et Ali ont arpenté la route de Schirmeck à la recherche d’illustrations des problèmes de pollution atmosphérique, de nuisances sonores et autres conflits d’usage de l’espace public.
Par la suite, les collégiens de la « classe média » se sont entrainés à réaliser des interviews radio. Certains d’entre eux ont interviewé une habitante de l’Elsau, Menouba, sur la question du ramassage des déchets dans le quartier. D’autres ont mené un entretien avec deux salariés de l’association d’insertion Elsau’Net pour mieux comprendre le quotidien d’un agent de nettoyage à l’Elsau.

Cinq élèves ont aussi été formés à l’animation d’un plateau radio, grâce au soutien technique de Speaker. Ce dernier a eu lieu lors des journées portes ouvertes du collège Hans Arp, dans l’après-midi du vendredi 24 juin. Ils y ont présenté l’exposition photo au CDI, les slams enregistrés par les collégiens sur leur quartier, deux reportages radiophoniques.
L’interview de Benjamin Soulet, adjoint à la maire de Strasbourg pour le quartier, était planifié mais il s’est désisté en dernière minute. Les jeunes journalistes ont ainsi découvert un autre aspect du métier de journaliste : les joies du direct et des imprévus !

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous
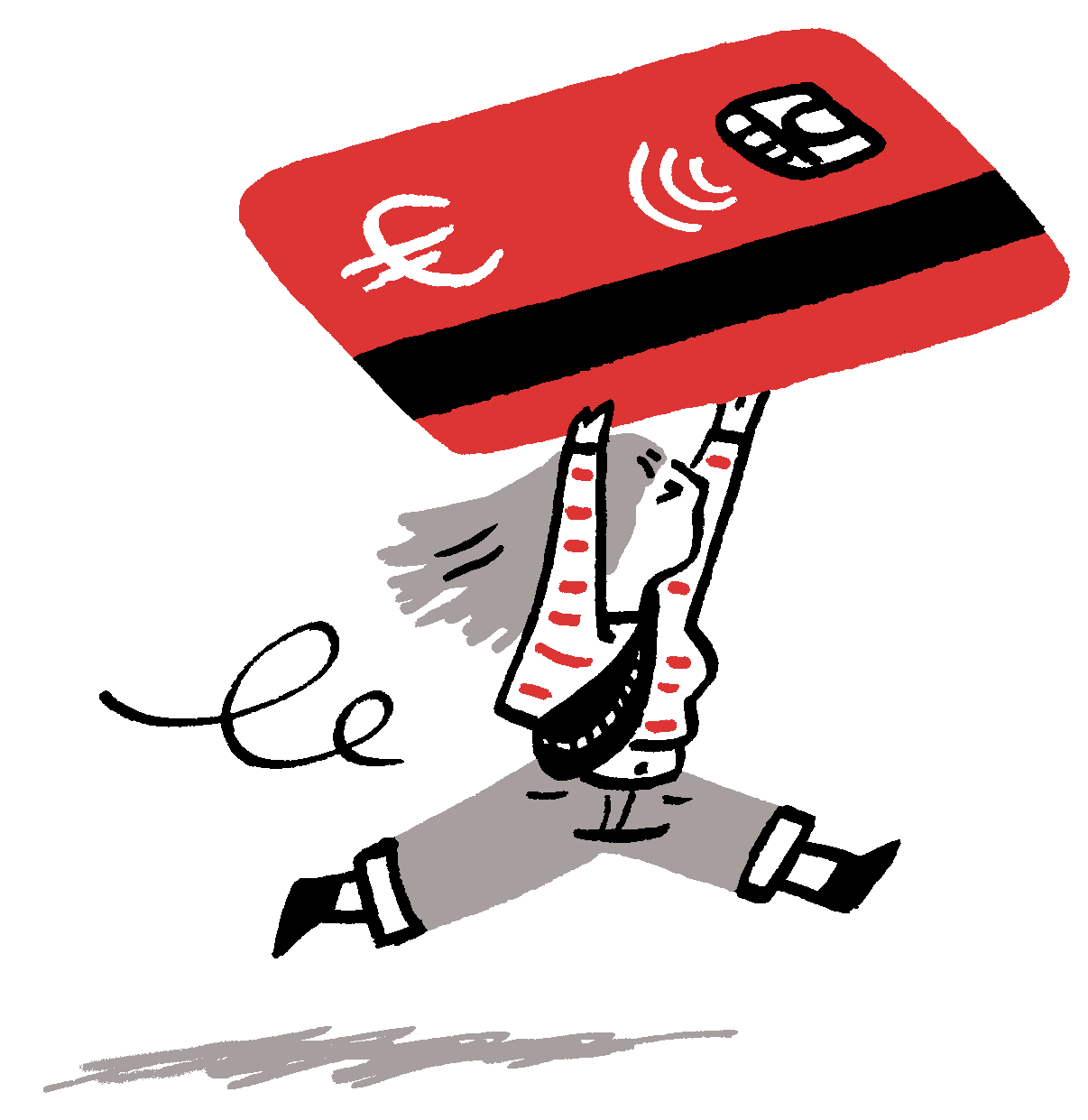
Déjà abonné⋅e ?
Connectez-vous
L’été 2022 marque le grand retour des fêtes dans les villes et villages d’Alsace. Ces grands moments collectifs semblaient intangibles dans le paysage régional. Il a fallu une pandémie mondiale pour voir ces événements balayés deux étés de suite.
Qu’est-ce que ce plaisir de se retrouver entre voisins, entre habitants d’un même village, entre passionnés d’un même truc ? Pourquoi ce besoin de se retrouver et de faire la queue sous le soleil pour choper une bière et un hot-dog à 4€ s’exprime tant ? Cet été, fini le masque, le passe sanitaire, les jauges, l’ère des barrières et de la « distanciation sociale », cette convivialité retrouvée, on va vous la raconter.
À chaque recoin son histoire, ses traditions : des feux de la Saint-Jean fin juin aux fêtes du vin en août, nous allons explorer chaque vendredi une petite part de l’identité alsacienne et française… Des reportages qui nous emmèneront des deux côtés du Rhin, ainsi qu’à un bal du 14 juillet ou bien à célébrer le bretzel à Gresswiller quelques semaines plus tôt.
Tous les week-ends, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’âme d’une association, d’une histoire, d’une commune, de ce vivre-ensemble si précieux. C’est la vie de stars du quotidien, des nobodys de tous les jours. Le genre de personnage qu’on ne rencontre que trop rarement dans Rue89 Strasbourg.

Cette série d’été représente un investissement considérable pour notre petite rédaction. Chaque reportage est réalisé par un rédacteur accompagné d’un photographe professionnel pour mieux faire ressortir l’intensité de ces festivités. Ces reportages étant disséminés en Alsace, il s’ajoute des frais de déplacements pour nos binômes de choc ! Comme chaque été, les 9 épisodes de la série d’été sont en accès libre. Soutenez cette production estivale et sa diffusion au plus grand nombre en optant pour un abonnement, sans engagement.

À Berrwiller, la Humpafascht n’est pas juste l’histoire d’une fête de village. C’est l’histoire d’un club de foot, l’Association sportive Berrwiller Hartmannswiller (ASBH), devenu une référence dans le Haut-Rhin, autant pour ses performances sur les terrains que son double week-end festif au début de l’été : la Humpafascht qui célèbre sa 44e édition. Un événement que beaucoup d’habitants de l’ancien bassin minier ne rateraient pour rien au monde.
Pour le club fondé en 1965, c’est aussi tout son équilibre économique et social qui repose sur ces six jours de fêtes. « La Humpafascht représente 60 à 70% des recettes annuelles du club », précise Alexis Wintenberger, responsable des sections jeunes. Une manne qui permet de proposer des licences au prix de 150€, survêtement et cotisation à la ligue compris, dans ce club « où il n’y a que des bénévoles et aucun salarié ».
La soirée d’ouverture est la plus intergénérationnelle et rassemble jusqu’à 4 000 personnes, bien plus que la population de Berrwiller et ses 1 200 âmes. Au programme, un grand feu d’artifice, un feu de la Saint-Jean et une « ambiance années 90 – 2000 ».
Face à l’entrée, Bertrand s’affaire avec un regard concentré pour mettre en marche un deuxième four à tartes flambées arrivé « ce matin ». Ce bénévole cinquantenaire participe chaque année à la Humpafaschst depuis « au moins 25 ans, c’est sûr ». Et même s’il ne tape plus dans les ballons, il est membre du comité des fêtes. Autour de lui, une équipe de huit personnes, « de toutes les générations », cinq hommes et trois femmes, qui vont enchainer jusqu’à 2h30. Ici, on connait la valeur d’une grande équipe de bénévoles, et de son renouvellement. « Une fête de village qui perdure c’est important. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, à cause du manque de bénévoles, des bagarres ou tout simplement parce que les organisateurs ne rentraient pas dans leurs frais », relève Nicolas, la quarantaine, à ses côtés.

Tony et Monique, 75 ans, font partie des premiers participants à passer la grille. « On a nos habitudes » explique le mari, une canne à la main. Ce soir-là, il s’agit de commencer avec un crémant « dans un gobelet en carton », ce qui ne satisfait pas complètement l’ancien routier qui avale également quelques frites. « Dans le temps on dansait, mais c’était une autre musique », complète Monique, sandwich à la main.
Le couple domicilié à Wattwiller vient « tous les week-end » à Berrwiller depuis 40 ans. Il faut dire que la famille est très impliquée : la fille est secrétaire générale du club, les petits enfants jouent et les arrière-petits enfants doivent rejoindre U7, les « pitchouns ». Et le gendre, dirigeant-arbitre le reste de l’année, « ce soir, c’est Monsieur frites ! », décrit sa belle-mère. Tony, lui, n’a joué au foot que jusqu’à ses 20 ans, avant de se marier après son service militaire, puis d’être sur les routes de France et d’Europe une bonne partie de ses semaines. Ils resteront jusqu’au bûcher, vers minuit.
À en croire Valérie, épouse d’un des entraineurs et bénévole au bar « la Humpafascht est une institution dans le secteur, les jeunes découvrent vers 15 / 16 ans. » À l’instar de ce groupe de collégiens venus de Soultz une semaine avant de passer le brevet. « On est venus s’amuser. À 5 euros l’entrée, ça a intérêt à être une bonne soirée », prévient Mejdi. Les quatre amis ont peu de lien avec le club. Seul le père d’un des adolescent est un habitué de cette fête.
Vers 15 ans, c’était aussi l’âge de la première Humpafascht de Sandra, aujourd’hui 47 ans et responsable des « Pitchouns », les joueurs de moins de 7 ans. Elle est venue avec deux copines de l’adolescence. Pourtant, la soirée a tout de même des allures de « première » pour les trois amies. Les maris sont partis assister à un concert de Metallica en Allemagne. « Ils étaient dégoûtés de voir que ça tombait le même soir », décrit-elle. Face à elle, Christelle, coiffeuse qui a découvert le club il y a 17 ans, loue le sérieux de l’ASBH :
« Le club a une réputation d’être convivial et très pédago. Mes deux gamins ont ensuite fait sport études à Colmar, même s’ils ne sont pas devenus professionnels. Quand ils sont adultes, les joueurs reviennent tous ».
Un attachement qui n’est pas sans poser des problèmes à l’équilibre conjugal. « À un moment, c’était le foot ou moi ! », avertit Christelle. Le compromis pour ne pas perdre ce lien si fort avec le club ? Entraîner les petits, qui ont moins d’entrainements, des matches plus courts et moins loin.

Il y a quelques années, c’était au tour de ses enfants de faire découvrir la Humpafascht à des amis adolescents de Paris. « Ça les a un peu décoincés », rigole la mère de famille. Et pour faire dormir les convives, « il suffisait de traverser les champs et d’aller dans les tentes dans le jardin ».
Derrière le bar, Joseph (ou « Seppi » en alsacien) a une mission précise : le ravitaillement ! Il doit veiller à ce qu’il ne manque jamais de fûts de bière ni de bouteilles au bar. Ce grand défenseur de 32 ans est arrivé au club à 18 ans, il n’a raté aucune Humpafascht depuis. « Tous mes potes sont ici maintenant ». Une situation qui l’a convaincu de quitter Cernay pour acheter à Berrwiller, « un village qui bouge ». Mais ce n’est pas le jour le plus important pour lui. Sa grande responsabilité, c’est d’organiser le Grempelturnier, le tournoi de foot déguisé qui clos la Humpafascht le deuxième dimanche :
« Il y a une cinquantaine d’équipes et quatre terrains. Le premier, c’est le folklore total : on a eu une équipe de touristes qui ont ramené les transats et le sable, ainsi que des animations type rugby, le foot-pong, ou ventriglisse, un deuxième pour les enfants et mamans, le troisième où ça joue déguisé mais plus sérieusement, et le dernier où là, ça joue vraiment. On est là dès 6h pour l’installation et le tournoi est de 8h à 19h non-stop ».
Pour se remettre, Joseph a une autre habitude : « À chaque fois, je prends mon lundi ». Ça tombe bien pour ce réparateur-chauffagiste « en été, ce n’est pas là qu’on a le plus de boulot ».

La soirée débute et les allées du club se garnissent. Chez les plus jeunes, on se regarde, on se jauge, on se drague. Et même si on vient à la cool, beaucoup ont soigné leur apparence, nouvelles coupes, ongles repeints…
La vie sociale du club ne se limite pas à deux week-ends de fête. Il y a aussi les soirées Nouvel an, les soirées moules-frites, les crêpes après les matches… « Le niveau et surtout l’ambiance », c’est ce qui a convaincu Émilien, 20 ans, à quitter le club de Richwiller pour venir à Berrwiller à l’âge de 16 ans. « Je suis arrivé seul, mais on s’intègre vite ici. Et la famille, ça suit ».
À cette soirée, il croise un ancien camarade du CFA de Mulhouse. « Ici il y a des potes, des gens du club, de la famille ». Habitant de Wittelsheim, il travaille comme carrossier en Suisse. « C’est 1h15 de route, mais on a le temps, je suis encore chez mes parents, je profite encore un peu ». Le reste du temps libre, c’est le foot et « la copine à côté ». Même s’il n’est pas dans l’équipe de bénévoles ce soir-là, on le retrouve plus tard à porter des fûts de bière avec Joseph.

Peu avant 22h, la foule s’anime. Une centaine de personne se presse autour des enceintes pour le blind test : Iron Man, The Mask, Pretty Woman, Jurrassic Park… Seules quelques notes sont jouées et chacun crie le plus fort possible dans l’espoir que la bonne réponse arrive aux oreilles du DJ, qui distribue quelques cadeaux. De grands « oooooh » de déception répondent aux « c’est pas ça » de l’homme au micro.
Aux platines, c’est Ian Kaçara, 34 ans, qui s’occupe de l’ambiance. « Je n’étais pas au club, mais la Humpafascht, c’était l’événement pour les jeunes des alentours », se souvient-il. Ce sont des « camarades de primaire », membres du club, qui l’ont contacté pour rajeunir l’événement il y a six ans et donner « une ambiance discothèque » aux soirées.
Sa nuit est loin d’être finie. À 1h, il laisse les commandes à un autre DJ et fonce vers le Rota, la boîte de nuit de Colmar où il officie chaque week-end. La Humpafascht est la seule fête de village qu’il anime cet été. Mais pour le samedi soir, il a même pris congés. Il reste jusqu’à la fermeture à 3h pour la soirée « Tsunami », à destination des plus jeunes. Au programme, percussions, body painting, show de flammes ou encore gogo danseuses…
Sous le chapiteau justement, c’est encore calme. Une simple musique de fond et de nombreuses tables permettent de se retrouver. En famille, Clément raconte avoir vite décidé d’inscrire son fils Enzo au club après avoir affronté l’ASBH. « On a joué ici avec mon équipe de Bollwiller et on pris une piquette ! » Cet ancien militaire de 30 ans, aujourd’hui électromécanicien, est très satisfait de l’ambiance. « Ils ont de superbes infrastructures. J’ai fait plusieurs gros clubs par le passé, mais il n’y avait pas cet esprit », explique ce natif de Haute-Marne, qui a notamment vécu à Mulhouse et à Brunstatt. L’ASHB, c’est 475 licences au total, ce qui en fait l’un des 5 plus gros clubs du Haut-Rhin. Les inscriptions y sont limitées, car le nombre de terrains et de bénévoles n’est pas extensible.

Il discute avec Bruno, une figure du club. « Ici c’est le bonheur » dit le retraité qui vient « quatre jours par semaine ». Seule inquiétude pour Bruno, la réaction des jeunes qui n’ont pas connu de fête d’ampleur pendant deux ans, pour cause de Covid. D’ailleurs, la Humpafascht dispose d’un imposant dispositif de sécurité avec une quinzaine d’agents de sécurité en coupe vent jaune fluo. Un mauvais souvenir est dans les mémoires : en 2007, une personne exclue de la soirée avait foncé avec son véhicule dans la foule causant un mort et 16 blessés. Tous les ans se tient un match à la mémoire du joueur de 21 ans décédé.

Dans quelques semaines, la famille de Clément va quitter l’Alsace « avec regret ». Il va rejoindre la Haute-Saône, se rapprocher de sa famille. Surtout, il a pu construire une nouvelle maison, pour le quart du prix de leur maison actuelle avec un terrain bien plus grand. « On n’a pas l’accent du coin et à Bollwiller, il y a comme une fracture entre le village et le lotissement, qui est en fait une cité dortoir. On n’a pas été complètement acceptés », regrette un peu le père de famille.

La difficulté de s’insérer en Alsace est un sentiment que comprend Frédéric, originaire du Doubs, et qui découvre aussi la fête :
« C’est vrai qu’il faut faire l’effort, comprendre la mentalité alsacienne et se faire adopter. Avec un bon vivant et amateur de bonne chair, ça se fait vite. C’est sûr que le vegan qui ne boit pas d’alcool est mal barré… »
Fête du cochon à Ungersheim, braderies, défilé de chars à Riquewihr… Avec sa famille de six personnes, Frédéric est un habitué des fêtes de villages. Des sorties à peu de frais pour toute la famille et une manière de « décompresser de la semaine » pour ce gérant en restauration d’entreprises pour qui il est important d’avoir « les week-ends et les vacances ». Ancien footeux, il entraine l’équipe des enfants de 11 ans au FC Buhl, un club du coin « et à quelques troisièmes mi-temps ».

L’Alsace une terre de fêtes qui s’ignore ? « On est surtout connus pour nos marchés de Noël », estime pour sa part Sandra avec son groupe de copine. Mais à écouter les trois femmes, « l’été on profite bien, ça ne manque pas d’endroits ». Parmi leurs sorties préférées, « la fête de la sorcière » à Rouffach.
Pour Frédéric, la renommée festive de l’Alsace est une évidence :
« Quand j’habitais dans le Doubs, c’était la grosse réputation. C’est dans les villages, pas dans les grandes villes que ça se passe, c’est plus petit mais il y en a partout. On faisait jusqu’à 1h15 de route pour sortir à Altkirch. »
Si le sourire est sur toutes les lèvres pour ce retour de la Humpafascht, la fête n’efface pas le souvenir d’une saison galère, avec le pass vaccinal imposé à la rentrée, puis les nombreux joueurs contaminés lors des vagues Omicron. « Dans notre division, six équipes sur douze ont fait forfait général, on n’a pas beaucoup joué. Il y a aussi des gens qui ont vu que la vie sans foot, ça allait aussi. On a galéré en alignant parfois des équipes sans remplaçant, heureusement que des vétérans sont venus dépanner », raconte Joseph. Tout le monde espère que « ça reparte » normalement pour septembre.

Il est 23h. Beaucoup de monde s’est déjà pressé le long du ruban en plastique pour être aux premières loges pour le feu d’artifice et le bûcher dans la nuit noire. On attend. D’autres entament quelques pas de danse sur le fond musical. Au loin, les pompiers s’animent. Pour Marine, venue avec une copine de Wintzfelden, c’est « un peu long ». « On voulait danser, on pensait que la musique démarrerait avant le bûcher ». Les fêtes de villages, « j’ai baigné dedans, c’est un passage obligé », raconte-t-elle : « On cible celles qu’on connait, ça change des boîtes, on y connait du monde et chaque village a son truc ». Les deux amies attendent notamment avec impatience les fêtes du vin en août.
Ce retard n’entame pas la patience d’Amélie et Arthur venus d’Ottmarsheim « fêter leur bac », à près de 30 minutes de route. « On attend la chaleur », explique Arthur qui a vu d’autres bûchers dans la vallée de la Thur. Pour Amélie, c’est une première. Arthur est surtout « étonné de voir autant de monde, beaucoup d’événements ont du mal à reprendre ». Comme une grande partie de sa classe, ils iront en BTS à Fougerolles (Haute-Saône) pour apprendre à gérer des exploitations agricoles. Arthur sait ce qu’il veut, il se voit à la tête d’une entreprise « céréalière et avec des vaches à viande ».
À 23h45, le feu d’artifice démarre enfin. C’est au tour des deux buchers de s’embraser. « Ça nous a pris 4 / 5 soirées avec un gars bûcheron du club », précise Joseph. Les flammes mettent quelques minutes à atteindre le sommet, et diffuser un peu de chaleur. Il éclaire le stade et la foule, happée par cette vision.
Les plus jeunes, eux, ne s’attardent pas face au brasier. Ils font demi-tour, passent devant le four à tartes flambée où l’on continue de s’activer et se pressent sous le chapiteau. Cette fois, les projecteurs multicolores balaient le plafond et le sol. Les tubes des années 1990 et 2000 tournent à plein et Ian Kaçara chauffe la foule. Il n’y a pas de temps à perdre, il reste à peine deux heures de fête.

La fin de l’année scolaire est imminente, mais c’est le début d’un autre temps fort dans les établissements : celui des mobilisations contre les fermetures. Après le collège du Parc à Illkirch-Graffenstaden, voici le collège Jean Monnet concerné par la disparition de deux classes.
À la rentrée 2022, le collège Jean Monnet pourrait passer de cinq à quatre classes de troisième et de quatre à trois classes de sixième. Magali, professeur et élue représentante des personnels redoute les conséquences :
« On sera 32 à 33 par classe contre 25 à 26 élèves en ce moment. Cela va pénaliser les redoublants et élèves sans affectation que l’on ne pourra pas reprendre à la rentrée. On a même pas la place pour être plus de 30 par classe. En salles de sciences, il n’y a que 30 places. En salle informatique, 15 ordinateurs… »
Des enseignants et parents d’élèves appellent à un rassemblement vendredi 1er juillet à 15h devant l’établissement.

Les professeurs mobilisés ont obtenu un entretien avec la recteur Olivier Faron mercredi 29 juin, accompagné d’inspecteurs et de son directeur de cabinet. « Il nous a dit qu’il était arrivé en mars, qu’il présenterait un projet à l’automne et qu’il n’avait pas les mêmes chiffres que nous sur les prévisions », relate Magali. Elle espère qu’une mobilisation puisse encore faire changer la décision.

L’entreprise allemande a décidé, le 30 juin, de lâcher son siège social flambant neuf dans le quartier d’affaires de Strasbourg pour rejoindre le 9ème arrondissement de Paris. L’objectif d’Adidas est de rassembler tous ses collaborateurs dans un seul et unique siège social afin de « renforcer la culture d’entreprise », a indiqué la direction générale du groupe.
Mathieu Sidokpohou, directeur général du secteur Europe du Sud pour Adidas détaille dans ce communiqué :
« Notre but est de permettre aux collaborateurs à Strasbourg de continuer leur carrière chez Adidas tout en renforçant notre culture d’entreprise avec un site unique dédié à tous. Nous prendrons le temps d’accompagner ces évolutions ces deux prochaines années pour que chacun se retrouve dans le projet d’entreprise. »

Le siège social strasbourgeois de l’entreprise fermera en juin 2024. Les salariés devront se plier aux conditions de mobilité fixées par la direction, indiquent les représentants syndicaux. En fonction du poste, l’entreprise pourrait faire preuve d’une « flexibilité inédite » en termes de télétravail. « Il serait ainsi question de trois à huit jours par mois sur site à Paris », indique Adidas dans son communiqué.
Le regroupement des salariés d’Adidas à Paris était déjà envisagé par le groupe début 2015, quand son siège français était encore basé à Landersheim près de Saverne. La direction alsacienne avait alors cherché une porte de sortie, craignant à l’époque un plan social déguisé car trop de salariés en fin de carrière n’auraient pas suivi. Il avait fallu une intense mobilisation des collectivités locales, pour « faciliter » un déménagement vers le nouveau quartier d’affaires de Strasbourg « Archipel » et trouver une nouvelle activité pour le siège historique, devenu une académie autour du vin.
Les pouvoirs publics voyaient là une « locomotive » pour le nouveau quartier d’affaires de Strasbourg, qui n’avait pas encore d’implantation de grands groupes à annoncer. Mais celle-ci s’annonçait déjà provisoire, puisque dès l’origine seul un bail de location de 9 ans avait été signé. (lire notre enquête). Adidas avait installé son siège à Landersheim en 1970.
Les salariés s’étaient brièvement mobilisé le 21 juin contre cette fermeture remise à l’ordre du jour au printemps.